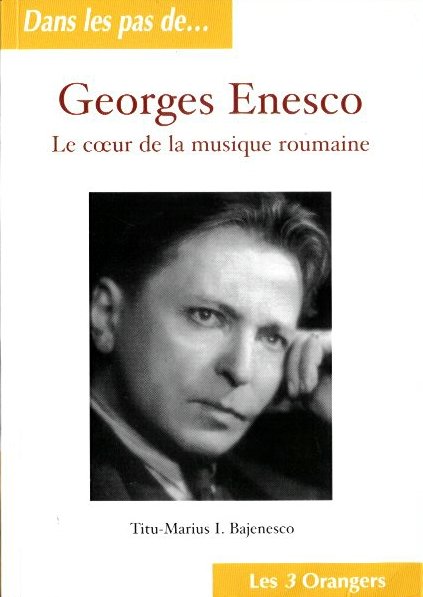Deux nouveaux livres sur Enesco
Heureux admirateurs d'Enesco
!
Deux livres récents en français viennent combler
un vide incompréhensible. Nous avons eu le plaisir de voir
apparaître dans les rayons des librairies, ces
dernières
semaines,
« Georges
Enesco » d'Alain Cophignon (Fayard)
et « Dans les pas de
Georges
Enesco – Le cœur de la musique
roumaine »,
de Titu-Marius I. Bajenesco (éditions des 3
Orangers). Voici quelques commentaires sur ce dernier ouvrage
dans les lignes qui suivent. A leur lecture, on comprendra pourquoi
j'ai souhaité publier dès aujourd'hui cet
article, sans
attendre d'avoir terminé de prendre connaissance du
livre d'Alain Cophignon. Une prochaine
mise à jour du
site comblera cette lacune.
Par
Alain Chotil-Fani
L'art du
biographe
Tout biographe d’artiste
est confronté à une épineuse
question. Chacun conviendra que la vie d’un personnage et
l’histoire des œuvres
qu’il a composées ne peuvent pas exister en
indépendance. La vie d’un artiste
est aussi la vie de ses compositions. Faut-il pour
autant justifier
rationnellement le processus artistique à travers ce que
l’on connaît de la vie
du personnage ?
Le mystère de la création est régi par
des phénomènes si
secrets et intimes qu’ils échappent à
tout un chacun. Dès lors, prétendre expliquer
l’œuvre par la minuscule connaissance
qu’un être humain aura, dans le meilleur
des cas, d’un autre être humain, relève
d’une approche forcément réductrice,
réduisant l’effroyable complexité du
processus créatif à un déterminisme
simpliste.
Aussi toute biographie se devrait-elle de privilégier les
faits, identifier les hypothèses, mettre en
lumière ce qui constitue l’identité
du personnage, la façon dont il contribua à
modifier la société dont il faisait
partie. Pour Enesco, l’on ne peut passer sous silence la
multitude de facettes
de son legs artistique, embrassant une dimension à la fois
cosmopolite et
nationale. Tout amateur de musique sera heureux de découvrir
des clefs pour
mieux pénétrer un monde complexe, si trompeur
pour qui ne connaît que la 1ère
Rhapsodie roumaine. Le citoyen un peu curieux de nature
sera étonné de trouver à travers
l’existence d’Enesco tout une histoire encore
récente et pourtant si mal connue
chez nous, alors que les jours avant l’admission de la
Roumanie au sein de
l’Union Européenne sont désormais
comptés. La vie d’Enesco embrasse à peu
de
choses près l’intervalle entre la
création de la Moldo-Valachie indépendante et
la mort de Staline. Soixante-dix années pendant lesquelles
le monde aura plus
changé que pendant soixante-dix
siècles…
La tâche du biographe
d’Enesco n’est certes pas aisée.
L’interprète a suscité une masse
imposante de
commentaires. Le
compositeur, en dépit d’un déficit de
reconnaissance du grand public, a
toujours joui d’une immense notoriété
auprès
d’un cercle d’amateurs
éclairés.
Le pédagogue engendra une filiation fertile sans laquelle
l’histoire de la
musique du XXe siècle aurait
été
différente. Et le personnage même
d’Enesco,
si impressionnant par la puissance de son intellect, doté
d’une mémoire prodigieuse
qu’il mettait tout entière au service de son
art ;
s’investissant corps et
âme dans des tournées invraisemblables qui le
menèrent aussi bien au contact du front de
la Grande Guerre aux confins de la Moldavie, que dans les
plus
importantes métropoles musicales ou au coeur de modestes
villages
roumains. Non,
la vie d’Enesco, tout en voyages et en musiques,
pétrie de
modernité et de
tradition, n’est certes pas d’un abord
aisé pour le
biographe.
Une goutte d'eau dans
l'océan
L’un de mes buts
avoués, lorsqu’en 1999 je décidais de
composer les quelques pages du site A
la
découverte de Georges
Enesco, était de refaire
naître l’intérêt de mes
contemporains mélomanes
sur un artiste scandaleusement méconnu. Sa mise en ligne
suscita divers
messages encourageants. Ils affluent toujours, d’ailleurs,
par quantités
petites mais régulières. Il sont
écrits par des mélomanes comme moi, des
connaisseurs, des violonistes, flûtistes ou chefs
d’orchestres. Ils proviennent
de France, de Roumanie et d’autres pays
européens ; des
États-Unis et du Canada, et même
d’Afrique et de Chine, d’où certains
virtuoses me demandent de leur envoyer des
photographies d’Enesco, pour mieux comprendre comment il
arrivait à faire
chanter son instrument de manière si extraordinaire.
C’est ainsi qu’une trop modeste contribution sur la
toile,
ténue goutte d’eau dans
l’océan de l’Internet, contribue
à sa manière à
éveiller l’intérêt de
quelques curieux sur l’immense musicien moldave.
C'est pourquoi aujourd’hui, en cette fin de
l'année 2006, je suis heureux de recevoir presque
simultanément deux livres en français
consacrés à Enesco. Nul ne saurait se
plaindre d’une telle abondance, étant
donné la courte bibliographie du
compositeur !
Je ne parlerai pas ici de l’ouvrage d’Alain
Cophignon
(Fayard) dont je préfère avant tout achever la
lecture détaillée. Dans
l’attente, voici, aux éditions des Trois
Orangers, « Dans les pas de Georges
Enesco – Le cœur de la musique roumaine ».
L’auteur, Titu-Marius I. Bajenesco, est
présenté comme « professeur,
ingénieur, journaliste », et surtout
mélomane plus qu’éclairé
puisqu’il suivit des classes de violon, de composition,
de contrepoint et de direction d’orchestre en Roumanie, avant
de s’exiler en
Suisse en 1969.
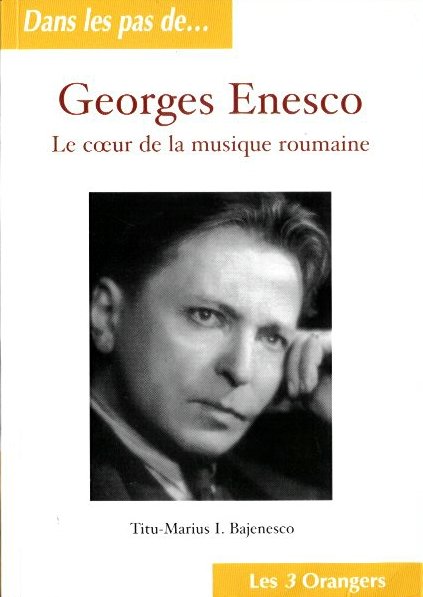
Couverture du livre «
Dans les pas de Georges
Enesco – Le cœur de la musique roumaine »
de Titu-Marius I. Bajenesco
287 pages - Préface d'Alexandre Hrisanide
Dépôt légal : septembre 2006 - ISBN
978-2-912883-55-1
Prix éditeur : 19,50 euros
Editions
Les 3 Orangers
(
www.les3orangers.com)
Similitudes
Chacun sait qu’en toute
chose, les aspects négatifs méritent
d’être évacués au plus vite
afin de terminer sur un élan positif. C’est
pourquoi je dirai sans tarder que la lecture du livre de M. Bajenesco
suscita
en moi de bien curieuses sensations. Ou bien des
réminiscences ? Voyons
donc, où avais-je donc pu bien lire un passage comme
« La
Première Guerre mondiale terminée, Enesco se
partage entre la France et la Roumanie. Tout en composant (certaines de
ses
compositions ont mûri pendant des années), il
continue à donner des concerts
pour assurer son existence. Son activité de
pédagogue prend aussi une
importance considérable. Dinu Lipatti (1917-1950) est son
élève ».
(« Dans les
pas de Georges Enesco », page
72).
Pris d'un doute, je
consulte mon site de 1999. Que vois-je sur la page intitulée
Une
vie ? La chose
suivante :
« La guerre
terminée, Enesco reprend une existence
partagée entre la France et la Roumanie. Tout en composant -
certaines de ses
oeuvres sont mûries pendant des années
entières - il doit continuer à donner
des concerts pour assurer son existence. Son activité de
pédagogue prend aussi
une importance considérable : Dinu Lipatti (1917 - 1950) est
son élève. »
(disponible en ligne sur
http://perso.orange.fr/alain.cf/enescu/une_vie.htm)
Convenons qu'il faut s'y reprendre
à plusieurs fois pour discerner les différences
entre les deux passages.
Coïncidence ? Continuons. Même page 72 du
livre, nous lisons :
« Yehudi Menuhin
(1916-1999) doit sans aucun doute l’épanouissement
de son génie à Georges
Enesco ».
Mon site dit :
« Yehudi Menuhin
(1916 - 1999) doit
l'épanouissement de son génie de violoniste
à Georges Enesco. ».
En page suivante du livre de
M. Bajenesco (2006) :
« Tout
le génie de Menuhin est transcendé par
l'enseignement d'Enesco qui inculqua
également une solide culture humaniste au jeune violoniste.
Cet enseignement trouvera
une illustration exemplaire après-guerre quand Yehudi
Menuhin prendra la
défense de Furtwängler et donnera plusieurs
concerts avec le chef
allemand. » (« Dans les
pas de Georges Enesco », page
73).
Ma propre page
(1999) :
« Tout le
génie de Menuhin est transcendé par
l'enseignement d'Enesco, privilégiant toujours la musique et
refusant la
virtuosité si séduisante pour susciter
l'adhésion du grand public.
Celui-ci inculque également une solide culture humaniste au
jeune violoniste,
un enseignement qui trouvera une illustration exemplaire
quand Yehudi
Menuhin prendra après-guerre la défense de
Furtwängler et donnera plusieurs
concerts avec le chef allemand. » (extrait de
http://perso.orange.fr/alain.cf/enescu/une_vie.htm)
Et ce n'est pas tout. Pages 73 et 74,
voici ce que l'on trouve :
« Comment Enesco
enseignait-il ? Ivry Gitlis rapporte que
« l’on
n’était pas son
élève, c’était
plutôt l’inverse,
tant Enesco était à l’écoute
des
autres. » Il se contentait
d’être et
cette attitude suffisait à faire passer une
conception musicale.
« Musicale et profondément humaniste, car
les deux allaient naturellement
de pair chez le Roumain », insiste Yehudi
Menuhin. » (« Dans les
pas de Georges Enesco », pages 73 et 74).
Mon site dit, sur la page intitulée Style
et témoignages :
« Comment Enesco
enseignait-il son art ?
Ivry Gitlis répond que l'on n'était pas son
élève, c'était plutôt
l'inverse,
tant Enesco était à l'écoute des
autres. Il se contentait d'être, et
cette manière d'être suffisait
à illustrer une conception musicale. Musicale
et profondément humaniste, car les deux allaient
naturellement de pair chez le
Roumain, insiste Yehudi Menuhin. »
(extrait
de
http://perso.orange.fr/alain.cf/enescu/style_temoignages.htm)
Autres similitudes et une anomalie
D’autres «
similitudes » apparaissent et il est sans doute intile de
noyer le lecteur par le jeu des sept (?) différences. Deux
remarques avant de conclure cet examen.
La note
au bas de la page 26 paraît reprendre les citations que
j’ai compilées sur ma
page Style
et témoignages
(http://perso.orange.fr/alain.cf/enescu/style_temoignages.htm).
Seconde
remarque, et c’est bien plus gênant,
l’une de ces citations est employée de
manière erronée dans son livre par l'auteur
de « Dans les pas de Georges
Enesco ». Cette citation ne concerne
nullement Enesco mais... Béla
Bartók. Il me semble que mon site est d’une totale
clarté sur ce point. Le lecteur en jugera :
« Cette alliance du savant et du
populaire en une entité supérieure est
sans doute la réussite la plus étonnante (...).
Sa démarche essentielle est de
n'avoir point rompu avec le passé mais de s'en
être imprégné en profondeur et
de l'avoir transfiguré en l'adaptant au monde moderne.
Ce passage, extrait de l'Histoire de la Musique de Marie-Claire
Beltrando-Patier, concerne non
pas Georges Enesco mais son illustre
contemporain
Béla Bartók. »
(extrait de
http://perso.orange.fr/alain.cf/enescu/style_temoignages.htm. La mise
en caractères gras a été
ajoutée dans le
cadre du présent article.)
Par un fâcheux raccourci,
cet extrait de l’Histoire de la
musique (Sous la direction de Marie-Claire Beltrando-Patier, Bordas
1982, ISBN
2-04-15303-9, p. 359) se trouve recopié tel quel page 111 de
l’ouvrage de M.
Bajenesco, chapitre « Impressions et
témoignages ». Témoignage,
sans doute ! Mais en l’occurrence, sur Béla
Bartók…
Exploiter le travail d’autrui, le faire mieux
connaître et
en tirer de nouveaux fruits, ainsi fonctionne tout travail de recherche
et nul
ne saurait s’en plaindre ; encore est-il fondamental
de veiller à conserver le sens des
sources exploitées et prendre garde de ne point les
défigurer. Et encore
faut-il apporter un soin particulier aux
références des travaux que l’on
exploite. Or ici, nulle mention de mon site, encore moins de son auteur.
Était-il si difficile d’insérer dans le
texte ou en bas de page « selon
Alain Chotil-Fani » ? Et où
était l'inconvient de faire apparaître
l’un
des seuls sites francophones consacrés à Enesco
et à la musique roumaine dans
la bibliographie finale ? Un silence fort regrettable.
Me voilà partagé
entre deux sentiments contradictoires. Le fait que mon site soit
exploité dans
l’ouvrage de M. Bajenesco (il l’est aussi dans
celui d’A. Cophignon, m’a-t-on
dit, mais j’y reviendrai) rend un honneur incontestable au
travail accompli et
au temps investi, dans l’intérêt de la
musique. L’auteur du livre doit donc
faire une petite place, sur son podium, à l’auteur
du site d’où il tira une
partie de ses ressources. Les deux devraient se trouver unis dans la
même remise
de lauriers. Mais voilà, l’hommage reste
désespérément muet, et si
l’inspiration est multiple, la récompense reste
sans partage.
Je laisse le lecteur se faire sa propre opinion
sur le
paradoxe d’un site bénévole, fruit
d’un
travail désintéressé,
exploité dans un
ouvrage vendu au prix de dix-neuf euros et cinquante centimes. Pour
terminer
sur ce sujet, nous ne pouvons qu’espérer que la
première édition de ce livre
s’épuise rapidement, afin qu’une seconde
édition puisse référencer correctement
les sources dans l’intérêt de tous les
mélomanes.
Autres remarques sur « Dans les pas de
Georges
Enesco – Le cœur de la musique
roumaine »
Cette seconde édition
pourrait en profiter pour corriger
quelques anomalies typographiques : les caractères
accentués roumains ne
sont pratiquement pas respectés, ce qui occasionne quelques
bizarreries. Ainsi en page 265,
"Costin" apparaît avant
"Cosbuc" au mépris de l'ordre alphabétique.
L'explication est simple : ce dernier nom s’écrit
en réalité avec un ṣ
(prononcé comme le "ch" de "charlatan"), et en
roumain le s précède le ṣ. Page 284, il
y a deux entrées à la lettre
« T » (en
réalité,
« T » et
« Ţ », qui se
prononce « ts »).
Le nom des
villes roumaines est étrangement
transcrit et pas toujours de manière
systématique. Par exemple,
Turnu-Severin (p.
198) est aussi
orthographié Tournou-Severine, p. 185. Par ailleurs, Cluj
devient Clouj, Sibiu
est transcrit Sibiou, etc. On peut comprendre la volonté
d’une transcription
phonétique pour le lecteur français peu familier
avec l’alphabet et la
prononciation roumains, mais dans ce cas pourquoi avoir
conservé
« Sighisoara » qui devrait selon
ce principe donner le curieux
« Siguichoara » ?
Dans le même esprit
l’on note la
présence de termes étonnants :
« viole » à la place
d’« alto »,
« dièze » au
lieu de
« dièse » ;
« resent » et non
« ressent », etc.
Sur le fond, l’on notera la
présence bienvenue d’annexes
conséquentes mais incomplètes. Les
créations de Georges Enesco (p. 240) mentionnent la 7ème Symphonie de
Chostakovich en 1945. Il s’agit naturellement de la
création roumaine
de cette partition, à la fin de la guerre (Samuel Samosoud
ayant eu le
privilège de la première mondiale en 1942).
Dès lors, si l’on parle de
créations nationales roumaines, il
faudrait aussi faire apparaître des
œuvres de Berlioz, Chausson, Debussy, Borodine et
même Beethoven, puisque
Enesco dirigea le premier l’intégrale de la
IXème
Symphonie avec chœurs, le 27
décembre 1914 à
l’Athénée Roumain !
L’annexe discographique (p.
243) est évidemment partielle,
omettant une bonne partie du catalogue enregistré
d’Enesco tel que
l’extraordinaire Musique pour cordes, percussion et
célesta de Bartók
(Besançon, Orchestre National de France, 6 septembre 1951)
parmi d’autres
archives éditées ces dernières
années (en l’occurrence : CD Tahra TAH
426,
« Hommage à Dinu
Lipatti »).
Le lecteur pourra
s’étonner du court commentaire sur les
deux Rhapsodies
roumaines. Il est vrai que leur popularité a
sans
doute nui à l’image
réelle d’Enesco dans le grand public, et
l’on peut trouver le choix de M.
Bajenesco entièrement justifié sur cet aspect.
Cela n’interdit
pas de penser que la présentation de ces deux
œuvres
(en note p. 99) est quelque peu légère.
Contrairement à ce que peut faire
penser cette note, la 1ère Rhapsodie
roumaine ne se limite pas à une citation
de trois airs populaires. On s’en convaincra sur la
page que j'ai consacrée à ces deux oeuvres
en 2005. Quant à
la seconde Rhapsodie
roumaine, Pascal Bentoiu lui-même
s’interroge dans son ouvrage de
référence « Capodopere
enesciene » (BUCUREŞTI, Editura Muzicală
ISBN 973-42-0231-6, 1999) :
« où est le
folklore ? »
Au sujet du 7ème Concerto pour violon en
ré majeur (K 271-a) de Mozart,
créé par
Enesco, il n’aurait pas été inutile de
rappeler la circonspection qui s'impose au sujet d'une telle partition,
dans laquelle l'esthétique mozartienne est
contrariée par des remaniements sans scrupules (l'on pourra
consulter le commentaire de Michel Parouty dans le
célèbre "Guide de la musique symphonique"
édité chez Fayard).
Enfin, on est
étonné de ne trouver dans l’index
final ni le
nom de Bentoiu ni celui de Ţăranu, deux figures
éminentes de
la musique
contemporaine roumaine et spécialistes incontournables
d’Enesco. Certes ces
personnages apparaissent dans le livre ; ils sont
néanmoins absents de
l’index. Là encore, espérons
qu’une nouvelle édition corrige ce petit
défaut,
car il n’est en rien insurmontable de compléter un
index avec trois noms
(au moins) d’où ils ne méritent pas
d’être absents.
Une densité enthousiaste
Alors, l’ensemble de ces
remarques justifie-t-il que l’on délaisse cet
ouvrage ? Ce n'est pas si simple.
Il serait dommage
d’ignorer un
travail intéressant, compilant un grand nombre
d’informations que l’on est
heureux de retrouver et avec cette densité dans un livre en
français, rendant
justice (et souvent de manière enthousiaste) à un
si grand artiste. L'on se réjouit aussi de cette
lecture alerte,
évitant les détestables
« descriptions
d’œuvres » dont certains
« spécialistes »
sont friands, y compris dans des collections dites de
référence, ce que l’on
aurait pu craindre d’un amateur
éclairé.
Ici, les œuvres de
maturité sont
diversement commentées. L’auteur a choisi de
détailler certaines pages
plutôt que d’autres (première
Suite orchestrale,
Troisième
Symphonie, Œdipe...),
étayant
son approche par des extraits de partitions.
Les curieux trouveront plusieurs
témoignages fort
intéressants (dont certains sont déjà
présents sur mon site) des contemporains
d’Enesco, un exercice courant dans les publications
roumaines. Certains
ouvrages de Viorel Cosma sont entièrement bâtis
selon ce principe.
Précisons que la partie
rédactionnelle n'occupe qu'un peu plus du tiers de
l’ouvrage, ce qui peu surprendre. Assez dense,
elle offre au lecteur un portrait parlant de l’artiste. Les
annexes importantes
intéressent aussi bien le chercheur que le
mélomane un peu curieux, et une
nouvelle fois nous nous félicitons de les trouver en langue
française. Dommage que les diverses réserves
citées plus haut nous poussent à
tempérer le plaisir de cette découverte.
Si l'admirateur d'Enesco sera sans doute
intéressé par « Dans les pas
de
Georges
Enesco – Le cœur de la musique
roumaine », il n'aura certainement pas attendu la
lecture des présents commentaires pour passer à
l'acte d'achat. A tous les autres, nous conseillons d'aller
feuilleter l'ouvrage en librairie et de se faire leur propre
opinion. Cela nous paraît
important car la taille des annexes, comme on l'a dit,
destinent ce livre plus à l'amateur
éclairé et au chercheur qu'au mélomane
lambda.
Épilogue (?)
Sitôt après m'être rendu compte
des similitudes entre l'ouvrage de M. Bajenesco et mon site web, j'ai
alerté l'éditeur de cet état de fait.
Il se déclare "consterné", me présente
ses excuses et s'engage à faire apparaître les
sources dans la prochaine édition du livre - si tant est
qu'il y en ait une.
Je prends donc acte de cette réponse, qui me
paraît tout-à-fait honorable. C'est pourquoi je
voudrais dire à ceux qui hésiteraient
à acheter le livre « Dans
les pas de
Georges
Enesco – Le cœur de la musique
roumaine »
à cause des similitudes indiquées dans les paragraphes
qui précèdent, de ne tenir aucun compte de ce
paramètre.
Pour terminer, je tiens à remercier très vivement tous
ceux qui m'ont fait part de leur soutien dans cette
"mésaventure", ainsi que ceux qui m'ont aidé
à mieux comprendre certaines subtilités du droit
d'auteur. Une meilleure connaissance qui risque - hélas ! - de
m'être utile dans le futur.
Alain Chotil-Fani