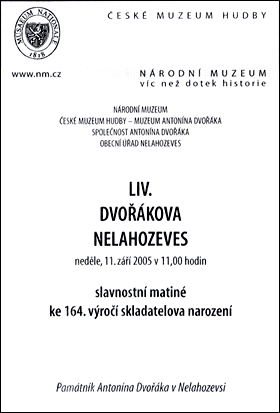
En me réveillant brutalement, ce matin-là à Prague, à cause du bruit des tramways, je ne pouvais que me persuader de la réalité de ce qui m'arrivait. Les longues recherches dans les bibliothèques parisiennes ; la synthèse difficile d'une masse disparate d'informations ; un simple article sur Dvořák et la France devenu, avec le temps, les découvertes et les révélations, un véritable livre ; l'intérêt affiché des musicologues de la Sorbonne pour ce travail et l'invitation au Colloque International Dvořák de Paris, en 2004. Et aujourd'hui, cette invitation à lire mes travaux à Nelahozeves, en présence de quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux du compositeur.
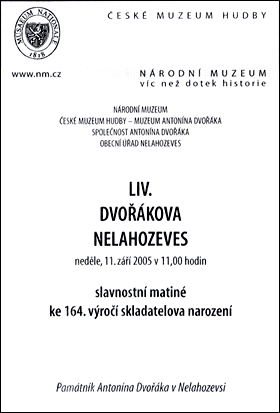
La veille, un rapide regard dans les archives secrètes du
Musée Dvořák m'avait permis d'admirer la médaille
d'or parisienne que j'ai eu l'heur de "redécouvrir" au cours de
mes recherches. Elle se trouve toujours
dans son
étui de cuir, telle qu'elle a été remise, voici
plus d'un siècle, en avril 1904, par les deux
délégués de la Ville de Paris, Ernest Gay et
César Caire. Remise certes, mais pas au compositeur,
déjà malade et astreint à domicile depuis la crise
qui flamba le soir même de la triste première d'Armida au Théâtre
National, le 25 mars 1904. Voilà peut-être pourquoi cette
décoration est restée si mystérieuse. Elle allait
devenir la possession de Magdalena, la fille de Dvořák - et
cantatrice appréciée de Grieg. A la mort de
Magda, dans les années 1950, la médaille fut enfin remise
au Musée... sans que personne ne se souvinsse
alors de son illustre origine parisienne. Le précieux objet prit
la direction d'un carton enfermé sous clef, qui devait dormir
jusqu'à ces derniers temps.
Sa photographie en grand format trône aujourd'hui dans la
pièce principale de la maison natale du compositeur, alors que
j'embrasse du regard l'assistance spécialement venue assister
à la "Dvořákova Nelhozeves" de ce 11 septembre 2005.
J'inspire à fond et - instant que j'appréhende depuis
plusieurs mois - je commence la lecture :
Régulièrement, je m'arrête, pour laisser le
temps à Mme Tauerová de lire la traduction en
tchèque. J'en profite pour jauger l'intérêt des
auditeurs. On
m'a dit qu'il y a là David Beveridge, l'un des meilleurs
connaisseurs de l'oeuvre de Dvořák. J'ai lu ses études
depuis longtemps - notamment un article sur les influences entre Brahms
et Dvořák, édité dans un livre américain (Dvořák
and his world) - aux conclusions assez surprenantes.
La traduction s'arrête. Je reprends la suite du discours, m'efface pour présenter la photographie de la médaille d'or quand j'évoque la délégation parisienne de 1904. Le public s'amuse de certaines réflexions que j'ai été récupérer dans la presse au sujet de la Symphonie du Nouveau Monde, s'anime au sujet de l'incident entre Pablo Casals et Gabriel Pierné autour du Concerto pour violoncelle. Je m'apercevrai plus tard, en discutant avec les auditeurs, que ces événement sont très mal connus en Bohême, même des spécialistes !
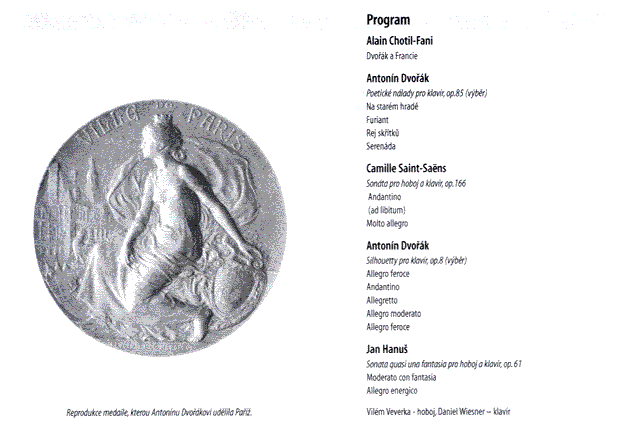
La lecture s'achève sans encombres. J'ai transpiré
mais n'ai pas bafouillé, encore que cela n'aurait pas eu trop de
conséquences. Applaudissements, je m'incline : me voilà
dans la
position du soliste rappelé sur scène ! On me remet
même une rose, comme si j'étais Rostro à la fin du Concerto en si mineur !
Après le concert qui termine la matinée, je
reçois encore des remerciements d'inconnus ; Marketa
Hallová,
une musicologue estimée de tous les amoureux de la musique
tchèque, me confie au sujet de la médaille d'or :
"même Šourek n'en parle pas..." Connaissant la très
haute estime dans laquelle les Tchèques tiennent (à juste
titre) les travaux du plus grand biographe de Dvořák, je ne peux
qu'apprécier la remarque.
On me présente enfin David Beveridge. Il m'annonce qu'il est en train de rédiger "le nouveau Šourek" - entendez, la nouvelle biographie exhaustive d'Antonín Dvořák. Quel travail monumental ! Il s'interroge sur certains aspects de ma lecture qui l'ont intrigués : j'ai en effet été contraint de passer très rapidement sur certains chapitres entiers de mon étude globale, en les résumant en une phrase, un mot. Cela n'a pas échappé au musicologue qui cherche à savoir où je suis allé chercher certaines opinions françaises étonnantes. Je lui livre alors le détail de quelques-unes de mes "découvertes" qui provoquent son hilarité ! Avant de nous quitter il me demande à quels travaux je me consacre désormais. Je l'informe que je ne suis pas musicoloque, ni même chercheur, mais que je passe mes journées derrière un bureau pour des tâches sans rapport avec la musique... Il s'étonne, pense comprendre de travers, et je dois le lui répéter plusieurs fois pour le convaincre que je ne suis qu'un passionné. Je me rends alors compte que je n'ai pas eu de conversation en anglais depuis l'oral du baccalauréat - ce qui ne date pas d'hier.
Je regrette l'absence de Mme Jarmila Gabrielová,
célèbre docteur en musique, au cœur des travaux sur
Dvořák. Elle m'a contacté quelques jours seulement avant
ma lecture. Elle s'excusait par avance de ne pouvoir se trouver
à Nelahozeves. Mais elle souhaitait surtout m'informer d'une
nouvelle péripétie qui devait encore me surprendre. Et "Dvořák
et la France" est, une nouvelle fois, au centre de cet épisode.
(à suivre)
Alain Chotil-Fani, 4 octobre 2005