|
C'est en 1900, à
l'âge de 19 ans, que le compositeur roumain termine son octuor pour cordes
op.7. La composition de cet octuor est, avec celle de la seconde sonate pour
violon et piano, un
événement de première importance :
l'émancipation du style d'Enesco qui "devenait
lui-même" d'après son propre
témoignage. En effet l'art d'Enesco est aisément
perceptible dans cet octuor luxuriant et puissamment
charpenté. Mais cette oeuvre marque aussi le premier divorce
entre le compositeur et le public, réclamant de nouvelles Rhapsodies.
Musique trop moderne, déjà, et même
rejetée par les interprètes.
Le dixtuor pour vents
op. 14 (1906) a toutefois été bien accueilli par
la critique parisienne. Si le début de l'oeuvre est d'une
tournure très brahmsienne, il s'agit néanmoins
d'une composition très personnelle, aux accents typiques de
Roumanie. La belle mélodie du second mouvement, au cor
anglais et au hautbois, a fait les délices de nombreux
mélomanes... et interprètes.
Des sonates pour
violon et piano,
seule la troisième
et dernière op. 25 est restée au
répertoire des grands violonistes de ce siècle.
Si la première est encore romantique et inspirée
par la musique française, la seconde plus personnelle mais a
priori dénuée des caractéristiques
roumaines si fréquentes chez Enesco, la troisième
est en effet un des plus admirables aboutissement de son auteur. Composée en 1926, la troisième
sonate pour violon est piano
est intitulée "Dans le caractère populaire
roumain" - Enesco a expliqué que par ce sous-titre,
également employé pour son  ouverture
op. 32, il entendait exprimer le fait qu'il a cherché
à concilier deux aspects "incompatibles" de la musique : la
structure savante de la sonate, et la substance musicale, homologue
à celle du folklore original. Du jeu 'improvisé'
du violoniste émane une sorte de puissance hypnotique.
Fascinant tableau de "l'atmosphère de la plaine roumaine la
nuit" au début du 2ème mouvement... Selon le
violoniste Serge Blanc, qui a travaillé cette oeuvre avec
Enesco, cette sonate très complexe et très
profonde exprime vraiment le fond de l'inspiration d'Enesco. On peut
également rejoindre Serban Lupu lorsqu'il parle du plus beau
des hommages qui soit aux lautars de Roumanie. ouverture
op. 32, il entendait exprimer le fait qu'il a cherché
à concilier deux aspects "incompatibles" de la musique : la
structure savante de la sonate, et la substance musicale, homologue
à celle du folklore original. Du jeu 'improvisé'
du violoniste émane une sorte de puissance hypnotique.
Fascinant tableau de "l'atmosphère de la plaine roumaine la
nuit" au début du 2ème mouvement... Selon le
violoniste Serge Blanc, qui a travaillé cette oeuvre avec
Enesco, cette sonate très complexe et très
profonde exprime vraiment le fond de l'inspiration d'Enesco. On peut
également rejoindre Serban Lupu lorsqu'il parle du plus beau
des hommages qui soit aux lautars de Roumanie.
Par bonheur, le disque a conservé des enregistrements de
cette oeuvre magnifiquement défendue par George Enesco
lui-même, accompagné de son filleuil Dinu Lipatti.
Il est impossible de ne pas mentionner les interprétations
du jeune Yehudi Menuhin, avec sa soeur Hepzibah.
Plus de trente années
séparent les deux quatuors
à
cordes, réunis
sous le même numéro d'opus 22. Le premier d'entre
eux (1921), présente, comme la seconde
symphonie,
des proportions étonnantes : plus de cinquante minutes !
Mais l'imagination constante, le souffle toujours renouvelé
de cette oeuvre, suffisent à maintenir l'attention de
l'auditeur en éveil. Le second quatuor, bien plus concis,
à l'écriture plus dense et plus profonde, fait
partie des chefs-d'oeuvres de la maturité (1952).
Les impressions
d'enfance
pour violon et piano op. 28
(1940) sont, comme la troisième
suite pour orchestre, une
évocation nostalgique de sa Roumanie natale. Cette suite de
dix tableaux fait appel à toutes les ressources du violon
pour jouer les rumeurs de la nature (souffle du vent, orage,
écoulement d'une source...), les cris d'animaux (le chant du
criquet et de l'oiseau en cage) ressenti par le jeune enfant. Cette
oeuvre est dédiée à son professeur
Eduard Caudella.
|
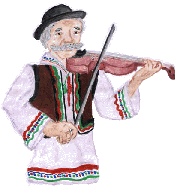
|