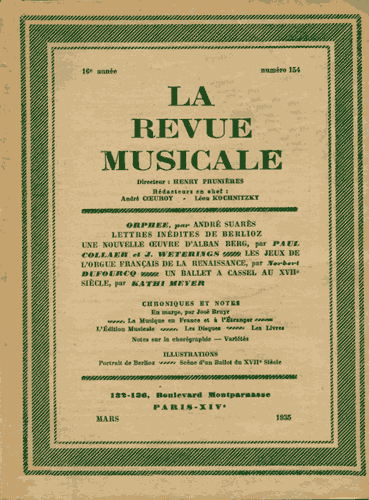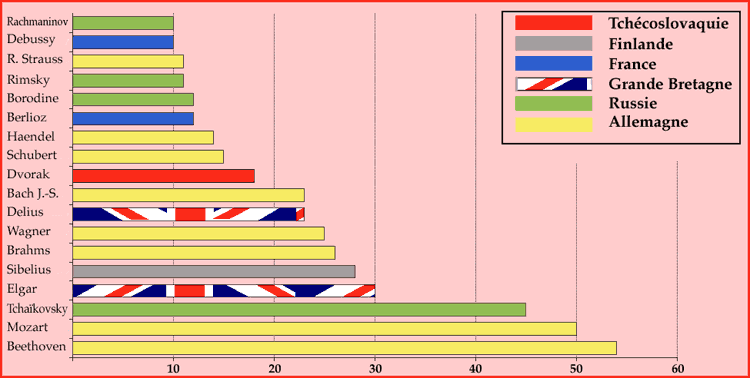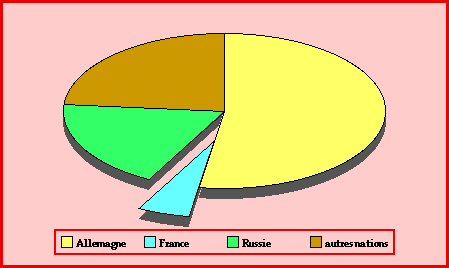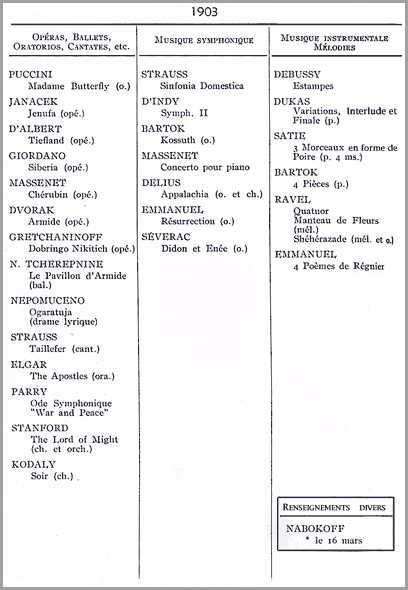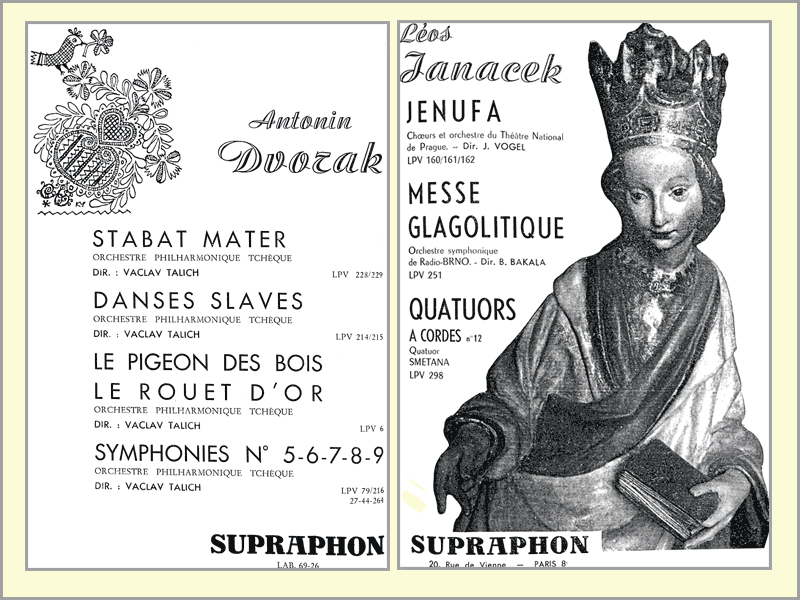La perception
française de la musique de Janáček
à travers les écrits (3)
La revue Musica
Avant d'examiner la Revue musicale, penchons nous sur une de ses
devancières, la revue Musica, première revue
française - illustrée de photographies - consacrée
à la musique qui parut mensuellement pendant 12 années,
de 1902 jusqu'en 1914 sur 143 numéros et connut une existence
plus réduite que celle de sa suivante. Un grand nombre de
compositeurs et de musiciens français, et non des moindres,
s'exprimèrent dans ces pages.
Un exemple probant de l'accueil ambigu et des rendez-vous
manqués entre la musique française et celle des pays
tchèque nous est donné par le numéro
127 d'avril 1913 de cette somptueuse revue Musica. Ses pages
illustrées de photographies accueillirent un numéro
presque entièrement dédié à la musique
tchèque. Un événement rare dans la presse musicale de l'époque !
Le panorama commençait pourtant bien par le portrait en
couverture de Smetana et en pleine page intérieure par celui
d'Antonín Dvořák. L'article qui ouvrait la revue brossait
un historique rapide, mais assez exact, de la situation des peuples
tchèques depuis la défaite de la Montagne Blanche en
1620. Il signalait la qualité de la musique à
l'époque baroque à travers les figures de Zelenka
et Mysliveček. L'acte de naissance de la musique tchèque
était signé par Bedřich Smetana à qui la
revue réservait une pleine page un peu plus loin. Antonín
Dvořák et Zdeněk Fibich, qualifiés de "deux plus grands
musiciens tchèques de la génération venue
après Smetana" furent placés sur un piédestal,
compte tenu de l'importance qu'on leur accordait. Comme au premier
nommé, on réserva une bonne page plus loin dans la revue,
le signataire de l'article curieusement intitulé
"l'activité musicale à Prague et en Bohême", Louis
Thomas, se concentra sur Fibich dont
il cita plusieurs opéras et poèmes symphoniques. De la
génération suivante, l'auteur plaçait
sur le devant de la scène trois personnalités, Karel
Kovařovic, Vítĕzslav Novák et Josef Suk dont il
détailla les principales œuvres. Il leur ajouta les noms
de J-B Foerster et Nedbal. Parmi les valeurs montantes de la nouvelle
génération, il citait Ostrčil, Karel, Křička, Vycpalek,
Kunc et Štĕpán. Cet article étalé sur une
double page s'illustrait avec six portraits photographiques de Fibich,
Nedbal, Kunc, Zemánek, Kovařovic et J-B Foerster.
Présenté comme le chef de la jeune école musicale
tchèque, un écrit de Vítĕzslav Novák
occupait la page suivante. Le compositeur s'efforçait de
définir les caractéristiques de la musique
tchèque. S'il y reconnaissait l'influence de la musique
allemande, il revendiquait "les fortes racines de la tradition
nationale tchèque" et "la culture de l'esprit slave". Au
Paganini tchèque, Jan Kubelik, une grande partie d'une page fut
consacrée alors qu'Antonín Dvořák jouissait de la
même surface un peu plus loin, mais le lecteur devait se
contenter d'anecdotes peu significatives sur l'homme, ces anecdotes ne
permettant pas de cerner la personnalité musicale du compositeur
et ses apports dans la musique tchèque. Un autre
journaliste parcourait la vie de Smetana, distinguant
particulièrement son opéra La Fiancée vendue au milieu de plusieurs de ses autres opéras, Les Brandebourgeois en Bohême, Libuse, Les deux veuves, signalant la force du cycle de poèmes symphoniques Ma Vlast et ses deux quatuors.
Une autre pleine page fut dévolue à Vítĕzslav
Novák au long de laquelle Raymonde Delaunois traçait la
carrière du professeur du conservatoire de Prague qui
exerçait "une influence considérable sur beaucoup de
jeunes musiciens tchèques." Elle commenta ses ouvrages
inspirés par la musique populaire slovaque, insista sur son
raffinement musical, sur son métier "chez lui tout est solide,
médité" et résuma son opinion le concernant par
une
déclaration qui quatre-vingt-dix ans plus tard ne s'est pas
vérifiée : "Lorsque l'on connaîtra l'œuvre de
Novak en France, il deviendra populaire comme Berlioz et Wagner le sont
devenus chez nous et au delà du Rhin."
Après une présentation des artistes du
Théâtre National de Prague accompagné de nombreux
portraits et d'une double page de photographies de décors de
plusieurs opéras tchèques, ce numéro se terminait
par l'évocation de la musique populaire tchèque par le
professeur Hanuš Jelínek, article rehaussé par
deux tableaux
du peintre morave Joza Uprka. Il cita tous les érudits des pays
tchèques qui recueillirent des chansons populaires. Du Slovaque
Jean Kollar aux Bohêmiens Čelakovsky et Erben, en passant
par les
Moraves Sušil et Bartoš, les grands collecteurs
étaient au rendez-vous. Il
alla jusqu'à préciser l'apport de F. Bartos avec ses
"trois grands volumes" (de chants populaires) et précisa
même que "le ministère de l'Instruction publique a
nommé une commission permanente dans chaque pays,
composée de connaisseurs en la matière, pour le
classement scientifique des chansons populaires."(Il s'agit des
comités de travail pour le chant populaire - voir l'article autres collectes) S'ensuivit une
étude rapide mais sensible des caractéristiques des
musiques des pays tchèques. "A l'encontre de
l'égalité pondérée de la chanson
tchèque, la chanson slovaque a plus de tempérament dans
l'expression de la gaieté aussi bien que de la tristesse"
notait-il pour distinguer les musiques de deux régions
différentes.
Après une lecture intégrale de ce numéro, quels
enseignements pouvait bien en déduire le lecteur attentif ? Si,
historiquement, les figures de Smetana et de Dvořák
émergeaient telles des balises indiquant la voie à suivre,
que
dire de la place dévolue aux autres compositeurs ? Ne jetons pas
trop fort la pierre aux différents rédacteurs de la
revue. Il n'est toujours pas très facile cent ans plus tard de
distinguer les caractéristiques, les mouvements
différents, les enjeux qui s'exprimaient entre les
différents acteurs de la vie musicale tchèque des
années 1900, alors en pleine actualité,
pouvaient-ils si facilement démêler les fils de cette
aventure musicale ? Remarquons toutefois que les musicologues et les
journalistes accordent toujours plus d'importance, à toutes les
époques, à un artiste bardé de diplômes
qu'à un autre plus modestement pourvu. Qu'ils attribuent
également toujours plus d'importance à un compositeur,
professeur au conservatoire de son pays, qu'à un autre
occupé à un poste jugé subalterne. Et qu'ils
accordent toujours plus de crédit à un musicien vivant et
exerçant dans la capitale qu'à celui résidant en
province. Ne nous étonnons donc pas de l'absence
de Janáček dans ce compte-rendu. Malgré le
succès local de Jenůfa
en 1904, le compositeur morave était toujours
ignoré par la plupart de ses collègues et les autorités
musicales de la capitale. Au demeurant, un compositeur habile,
avisé, dans le fil du courant trouve, de manière
générale, plus souvent grâce
aux yeux de ses concitoyens qu'un autre qui ne respecte pas les canons
du moment et qui de plus n'est qu'un obscur directeur d'une banale
école de musique provinciale dont le retentissement et le
sérieux ne peuvent approcher celui du conservatoire de la
capitale. Comme ses compatriotes pragois voyaient Janáček,
les journalistes français le voyaient également.
Ignoré à Prague, le compositeur morave le restait
à Paris !
Même le professeur Jelínek, pourtant d'origine tchèque, ne
soulignait pas son apport dans la connaissance de la musique populaire.
Pourtant la jaquette du troisième volume de Bartoš
portait bien la double signature du dialectologue et
de Janáček ("arrangement musical fait par…" comme
indiqué sur la couverture). Pourtant, Janáček
occupait le poste de président du comité morave du Chant
populaire en Autriche. Le
différends entre Bohêmiens et Moraves trouvait son
prolongement jusqu'en France !
Avant de clore ce compte-rendu, remarquons la personnalité de
deux de ses rédacteurs. Raymonde Delaunois, mezzo-soprano
d'origine belge engagée successivement en 1913 à
l'opéra de Prague et à celui de Budapest (Mignon d'Ambroise Thomas et Carmen)
était mariée à Louis Thomas, écrivain
prolifique couvrant des champs très larges. Les deux
époux offrirent très certainement leurs services à
la revue Musica où ils furent reçus favorablement tant
les connaisseurs français de la musique de cette contrée d'Europe
centrale se comptaient sur les doigts d'une main. La cantatrice,
engagée au Met de New-York en 1915 avant de monter sur les
planches parisiennes de l'Opéra-comique, avait fait provision de
musique lyrique de Fibich, Suk et Novak, compositeurs prisés
à Prague à cette époque. Le couple Thomas exporta
aux lecteurs français les succès bohêmiens. Et
comme à Prague on regardait avec condescendance ce qui se passait
en Moravie et à Brno en particulier, il n'était point
étonnant que la cantatrice n'ait pas été en
contact avec la musique lyrique de Janáček, ignorée
obstinément dans la capitale des pays
tchèques. Kovařovic, chef du Théâtre National
à Prague, régnait en maître sur la programmation de
l'opéra, écartant tel compositeur, favorisant tel autre,
élevant un barrage efficace contre l'exécution de Jenůfa depuis une décennie. La bataille de Jenůfa engagée depuis plusieurs années n'avait pas encore abouti…
L'exemple de la
Revue musicale
Fondée en 1920 par André Coeuroy et
Henry
Prunières qui la dirigea jusqu'en 1938, la Revue Musicale,
d'une
longévité exemplaire
bénéficia dans le
milieu musical d'une auréole bien
méritée. Haut
lieu d'une musicologie à la fois accessible et exigeante,
sous
la
houlette de son directeur, elle s'illustra mensuellement dans la
promotion de la musique contemporaine. Prunières,
élève de Romain Rolland à la Sorbonne,
resta
fortement impressionné par son maître. Il consacra
ses
talents d'historien de la musique à la rédaction
de
livres sur Lully, Monteverdi, Cavalli et l'opéra
vénitien. Il consacra ses autres talents de
témoin
attentif et humaniste à la musique de ses contemporains.
Cofondateur avec le musicologue anglais Edward Dent de la
Société Internationale de Musique Contemporaine,
(1) il
suivit de près chacun des festivals que la
Société
organisait régulièrement. C'est sous sa plume que
pendant
longtemps on en trouva des comptes-rendus dans sa revue. Rarement un
directeur aura autant imprégné son entreprise
intellectuelle et
artistique de son érudition, de sa militance, de son
ouverture.
Cette phrase écrite par Prunières en page 63 du
numéro de janvier 1921 de sa revue éclaire en
grande
partie son orientation "le manque de curiosité du public,
à l'égard de ce qui se fait de nouveau, tant en
France
qu'au dehors, est affligeant." Par ses écrits, par son
action, il essaya d'y remédier.
(1) Société que nous désignerons
désormais uniquement par ses initiales : SIMC
Cette revue
couvrait les événements de musique vivante
(comptes-rendus
de concerts et de festivals), mais surtout offrit aux
mélomanes
de l'entre deux guerres des études particulières
sur les
écoles musicales et les compositeurs vivants et ceux du
passé,
des critiques de livres et même des premiers disques 78 tours
de
musique savante. Elle organisa également des concerts
certains
mardis pour promouvoir la musique contemporaine qu'elle vienne de
France ou de l'étranger. Henry Prunières tout au
long de
ses années de direction s'entoura de collaborateurs
réguliers et fit aussi
appel à des correspondants dans les capitales et grands
centres
musicaux européens. Comment chaque numéro
était-il
organisé ? Il comprenait généralement
quatre ou
cinq études (2), dans lesquelles on pouvait mesurer la
vaste érudition des rédacteurs, que
suivait une
copieuse rubrique intitulée "chroniques et notes" qui
passait
en revue les concerts en France et dans d'autres pays d'Europe, qui
examinait les parutions discographiques et les livres de musique.
Le tout sobrement agrémenté de lettrines
élégantes et de bandeaux. Malgré les
moyens
techniques limités de l'époque,
il n'était pas rare de découvrir un bois
gravé
campant le portrait d'un compositeur, remplacé un peu plus
tard
par des
héliogravures. Presque chaque année, un
numéro entier était dédié
à un
musicien ou à un thème particulier, par exemple
Debussy
en 1920, Fauré en 1922, Wagner et la France en 1923, Ronsard
et
l'humanisme musical en 1924 (3), Ravel par deux fois en 1925 et en
1938, la
jeunesse de Debussy en 1926, Beethoven en 1927, Liszt et Schubert en
1928, Albert Roussel par deux fois en 1929 et 1937, la musique
mécanique en 1930, une géographie musicale en
1931, Bach
en 1932, Mozart en 1933, l'Opéra-comique au 19e
siècle en
1933 également, le film sonore en 1934, Paul Dukas en 1936.
Une
telle liste laisse entrevoir la largeur de vue des
promoteurs de la revue en même temps que leur
lucidité
face aux bouleversements techniques et artistiques survenus en cette
période. Ajoutons que le jazz et les musiques
extra-européennes savantes et traditionnelles ne furent pas
délaissées. Peu de mouvements
échappaient à
leur perspicacité, ainsi des articles copieux
signalèrent
Bela Bartok en mars 1921 (rédigé par son
compatriote
Zoltan Kodaly), l'œuvre de Stravinsky en juillet de cette
même année (écrit par le chef
d'orchestre Ernest
Ansermet), Jean Sibélius en mars 1922, Szymanowski deux mois
plus tard, les deux styles de Monteverde en juin 1922 - compositeur que
l'on redécouvrait et dont on écrivait ainsi le
nom alors
que nous sommes habitués maintenant à Monteverdi
- le
mois suivant quinze pages
évoquaient les symphonies de Mahler, pour la plupart
inconnues
en France, alors que Louis Laloy esquissait les principes de la danse
cambodgienne et l'on pourrait continuer longtemps
l'énumération tant elle est
variée…
(2) les
articles du
numéro
d'avril 1935 balaient des sujets larges et des aspects tantôt
connus et tantôt méconnus de la musique :
César Cui
(3 pages), Carl-Philipp-Emmanuel Bach
(11 pages), La naissance de la musique autrichienne au XVIIe
siècle ou de la barcarolle à la valse (8 pages),
Sur
l'évolution de la musique française avant et
après
Debussy (17 pages)
(3) avec dans le supplément musical, les partitions
commandées par la Revue musicale elle-même
à Louis
Aubert, André Caplet, Maurice Delage, Paul Dukas (Sonnet
à Ronsard), Maurice Ravel (Ronsard à son
âme),
Alexis Roland-Manuel, Albert Roussel.
C'est donc essentiellement à travers l'exemple de "La Revue
Musicale" que seront examinées les tentatives de diffusion de la musique
de Janáček par des écrits
musicologiques.
M'appuyant sur les
remarquables travaux de Marianne Frippiat parus dans le livre
récent l'Attraction et la nécessité,
ouvrage
collectif sous la direction de Xavier Galmiche et Lenka Strenska, j'ai
cherché quand et à quelle occasion le nom de
Janáček apparaissait dans les colonnes de la revue et plus
généralement l'école musicale
tchèque.
A) jusqu'en 1928
La musique tchèque
La musique tchèque fit son entrée à la
Revue
Musicale en mars 1921 par un coup double : un article de
Léon
Vallas relatant le premier concert
tchèque à Lyon (Suk,
Novák, Štĕpán, Křička
et Vycpalek) et la
note rédigée par le compositeur et
pianiste
Václav Štĕpán, note concernant
à la fois
V. Novák, son maître et la vie musicale
en
Tchéco-Slovaquie (comme l'orthographiait alors la revue).
Štĕpán
récidiva en novembre décrivant en trois points la
vie
musicale tchèque : la musique française
à Prague,
la Société de musique moderne, les
œuvres nouvelles
des jeunes auteurs tchèques (Vomáčka,
Jirák, Tomášek).
Dès le début
de l'année 1922, cette musique tchèque se
retrouvait sous
les feux de l'actualité par une note de
l'écrivain
Georges Duhamel qui lors d'un voyage à Prague
avait
assisté à un concert où
il avait entendu des
pièces de Novák,
Suk, Vycpalek, Vomáčka et Štĕpán. Le
mois suivant,
un assez long article de trois pages prenait place dans la rubrique
"Chroniques et notes" et parcourait le siècle d'existence de
la
musique tchèque de Smetana à
Štĕpán en
passant par Dvořák, Fibich, Kovařovic, Janáček,
Foerster,
Novák, Suk, Karel, Jirák, Křička, Vycpalek, Kunc,
Jeremias et Vomáčka, un concentré d'histoire
musicale,
sans toutefois un essai de hiérarchisation. Au moins, le
lecteur
pouvait-il noter ces noms dotés d'une graphie un peu
décourageante pour nos habitudes françaises. Au
mois de
juin, le nom d'Ottokar Zich pour la représentation
de
son opéra Vina
(la Faute)
à Prague rejoignait la liste
précédente auquel le
rédacteur Fr. Grepl ajoutait Chlubna pour
l'exécution
d'un poème symphonique avec solo de chant et Zamrzla pour
une
symphonie, Mors et Vita.
Suivait la relation d'un concert où des ouvrages de musique
de
chambre de Smetana étaient interprétés
par le
pianiste Jan Herman et le Quatuor Tchèque. En juillet, une
notice nécrologique saluait le violoniste
František
Ondříček qui venait de disparaître et
présentait la
maison d'édition Hudebni Matice, nouvelle occasion de
décliner le nom de plusieurs compositeurs
tchèques. En
août de cette même année, on rendit
compte du concours national des chorales tchécoslovaques
permettant d'ajouter les noms de Knahl,
Křížkovský et d'Emil
Axman. Cette année 1922, signait
réellement l'entrée de la musique
tchèque dans les
revues françaises.
En 1923, Léon Vallas reprenait une partie de l'article qu'il
avait rédigé pour le Salut public, quotidien
lyonnais
pour présenter aux lecteurs de la Revue le Poème de
Štĕpán, alors qu'en mai, une note sans signataire
évoquait l'audition aux concerts Straram, à
Paris, du
poème symphonique Prague
de Josef Suk, "aux tendances fortement wagnériennes."
Puis vinrent les
treize pages de Blanche Selva, en juin, brossant un portrait de la
jeune génération musicale tchèque.
Pour la
première fois dans la revue un article conséquent
dévoilait un monde musical du centre-Europe dont seules les
figures énigmatiques de Smetana
et Dvořák avaient
réussi à se frayer un petit chemin jusqu'en
France. Alain
Chotil-Fani, dans un ouvrage à paraître chez
Buchet-Chastel, montre fort bien les difficultés de
pénétration de la musique du compositeur de la Symphonie du Nouveau Monde.
Comme l'appel d'une vigie signalant un territoire musical inconnu qui
se révélait à l'horizon, Blanche Selva
s'attacha
tout d'abord à
définir les caractéristiques de la chanson
populaire de
chacun des trois pays : la Bohême, la Moravie, la Slovaquie,
"racines de toute cette floraison" de musique. Elle présenta
succinctement celui qu'elle considère comme l'accoucheur de
la
musique tchèque, Smetana. Par contre, elle ne manifesta pas
une
grande attention à Dvořák dont elle se contenta
surtout de relever l'influence sur la génération
future
par les nombreux disciples qu'il sut former. En suivant la chronologie,
elle cita Fibich "moins spécifiquement tchèque
sans
doute", Janáček et enfin Foerster, un peu en marge. Puis
vinrent
les deux musiciens Novák et Suk qu'elle
considérait comme
"les deux grands pivots de l'école tchèque
entière" et qui "ont porté la musique
tchèque, en
eux-mêmes, à une élévation
et une grandeur
qu'elle ne connaissait pas encore." se contentant pour chacun d'eux de
définir leur style musical se modifiant au fur et
à
mesure de leur évolution sans citer la moindre de leurs
œuvres, comme si celles-ci pouvaient être connues
par ses
lecteurs. Elle lista ensuite la troupe de compositeurs qu'elle groupa
dans ce qu'elle
appela la jeune génération : Rudolf Karel, Otakar
Ostrcil, Jaroslav Křička, Otakar Sin, Ladislav Vycpalek, Jan
Kunc,
Jaroslav Novotny,
Boleslav Vomáčka, Václav
Štĕpán à qui
elle consacra une pleine page, Vílem Petrželka,
Jaroslav
Jeremias,
Karel B. Jirák et Jaroslav Tomasek. Pour chacun de
ces
musiciens, elle s'attarda à énumérer
leurs
ouvrages, y compris les plus récents. "L'exposé
qui
précède, du moins, permettra peut-être
à
quelques-uns qui l'ignorent encore, d'être avertis de
l'intérêt grandissant qu'offre la vie musicale
tchèque, et les espoirs heureux qu'on peut fonder sur une
pléiade de jeunes compositeurs ardents, talentueux,
d'aptitudes et de tendances diverses, mais alliant tous un
sincère respect de leur art à ces
qualités
naturelles et acquises, s'échelonnant de
l'agréable
facilité musicale ou des essais encore un peu gauches mais
déjà intéressants, aux dons les plus
hauts et
à la possession assurée de la
véritable
maîtrise." conclut-elle. Que pouvait faire le
lecteur alléché par la qualité d'une
telle
nomenclature ?
Soigneusement ranger la revue sur un des rayons de sa
bibliothèque et scruter attentivement les programmes des
futurs
concerts pour y trouver peut-être un de ces noms…
Après ça, le
compte-rendu par Alexis Roland-Manuel, intime de Ravel, de deux
ouvrages de Hans Krása pourrait passer pour anecdotique.
Pour clore l'année,
Carol-Bérard rédigea la relation d'un concert
parisien de
musique tchèque présentant des pièces
de Smetana,
Nesvera, Novák, Dvořák, Křička
et Václav
Kaprál. L'année suivante, en février,
la Revue
annonça la redécouverte du manuscrit de la
première symphonie de Dvořák, les Cloches de Zlonice.
En avril, Marc Pincherle fit part de son émerveillement face
au
jeu d'une jeune violoniste polonaise qui révéla
une Suite
pour violon seul de Suk. En août, Marie Dormoy relata les
trois
concerts d'un festival de musique tchéco-slovaque, tenu aux
Champs-Elysées à Paris, avec la venue de la
Chorale des
Instituteurs de Prague, du violoniste Jaroslav Kocian, du pianiste
Jan Herman et du chef Václav Talich. Les Parisiens
entendirent
des œuvres de Suk, Foerster, Dvořák,
Novák, Smetana
dont l'ouverture de la
Fiancée vendue "dont nous souhaitons
vivement l'audition complète à
l'Opéra" ajouta la
rédactrice. Toujours en août, André
Cœuroy
signalait la parution du récent livre de Max Brod
"Sternenhimmel" dans lequel il relevait plusieurs pages
consacrées à Janáček, mais aussi
à Suk et
Novák. En octobre, Smetana se vit octroyer un article de
dix pages dû à la plume d'Etienne Fournol, alors
que dans une
chronique présentant la musique à quarts de ton,
Ivan
Wischnegradsky citait Alois Hába, compositeur de la jeune
génération. Pour faire bonne mesure, le
rédacteur
en chef Henry Prunières suivait de près le
festival de la
SIMC à Salzbourg où il nota : "L'Ecole
tchèque
n'était représentée que par un petit
nombre
d'œuvres assez peu significatives : d'agréables
lieder de
Ladislav Vycpalek fort bien chantés par Marya Freund, des
pièces de piano insignifiantes de Boleslav
Vomáčka, enfin
admirablement jouées par le compositeur Václav
Štĕpán, qui avait mis son talent de pianiste au
service
de ses compatriotes, de charmants morceaux de K. B. Jirák
sans
prétention certes à l'originalité,
mais à
coup sûr d'une veine heureuse, pleins de vie et d'esprit."
Pour
terminer, André Cœuroy faisait part de sa lecture
assez
critique du petit livre que, dans son pays, Nedjedly avait commis sur
Smetana. Entre
modération et enthousiasme, les pages consacrées
à
la musique tchèque dans la Revue Musicale au cours de ces
trois
années, 1922, 1923, 1924 concourraient à la prise
de
conscience de la musique d'un pays qui aspirait à
la
reconnaissance internationale. Notons que ce mouvement
d'intérêt
coïncidait avec un certain engouement pour cette musique que
diffusèrent plusieurs concerts. Cette relative attention
allait-elle
durer ?
La fréquence des chroniques tchèques faiblit
assez nettement en
1925. Toutefois, on salua un quatuor de Hans
Krása en mars 1925 et on mesura l'importance d'un festival
parisien Smetana qui obtint le succès grâce aux
talents
d'interprètes tchèques et français
parmi lesquels
il convient de relever le nom du violoniste Robert Soëtens. En
juin, le Festival de la SIMC à Prague dont "l'organisation
était parfaite" et "l'hospitalité
tchèque
proverbiale […] laissera un souvenir inoubliable" aux
délégués, fournit à Henry
Prunières
l'occasion d'un long développement sur l'état de
la
musique contemporaine. La musique tchèque ne profita pas de
cet
avantage pour briller, l'ouvrage de Novák
déjà
ancien et celui de Rudolf Karel ne convainquirent pas pleinement le
directeur de la Revue. En octobre, on annonça la Fiancée vendue de
Smetana à l'Opéra de Paris pour la saison
suivante. Au
printanier festival de la SIMC de Prague succéda l'automnal
festival de Venise. Deux manifestations la même
année, voilà qui
devrait prouver la bonne santé de la musique contemporaine !
Pourtant, le ton adopté par Prunières ne
rejoignit pas cet
optimisme : "Un peu partout, on marque le pas, un peu partout on se
sent las de battre les fourrés, on aspire au repos, au
calme,
aux larges horizons. Ne sachant plus trop quel parti tirer des
révolutions accomplies, on aspire à instaurer un
nouveau
classicisme et l'on regarde vers le passé. Bach plus que
jamais
apparaît comme le dieu qui ramènera la paix et la
lumière." La musique tchèque tira son
épingle du
jeu par les contributions de Janáček et de
son quatuor (le premier), de "belles mélodies
religieuses de Vycpalek et d'une longue sonate d'Arthur Schnabel".
Etonnons-nous simplement que ce magnifique pianiste, natif d'une terre
devenue polonaise depuis la fin de la guerre, ait pu être
comptabilisé parmi les Tchèques ! Si la
monographie
de Janáček d'Erwin Felber n'avait pas paru en
août
1926 dans la Revue Musicale, en dehors de quelques notes
éparses
ici et là signalant l'exécution d'une sonate de
Jaromir
Weinberger à un des Mardis de la Revue ou
l'édition de
quelques ouvrages de Novák et
Křížkovský dans
leur pays et Štĕpán chez Rouart, Lerolle et Cie,
cette
année serait restée muette sur la musique
tchèque.
1927 prit le même chemin. En dehors d'une sobre citation de
Josef
Mysliveček parmi les études de Marc Pincherle, de la
critique
positive d'André Tessier du livre "Smetana" de
l'ethnomusicologue Julien Tiersot (une édition
française), de la brève mention de la
première
audition américaine de la "vigoureuse Sinfonietta" de
Janáček par Otto Klemperer, de l'édition par
Universal de la partition de Vec
Makropoulos
et sa préparation pour l'opéra de Prague, du
festival de
la SIMC à Francfort avec la livraison tchèque due
à Janáček, d'un billet d'Aloïs
Hába peignant la
vie musicale à Prague, indiquant de nouveaux compositeurs
: Bořkovec, Šin,
Ullmann, Schlhoff et signalant la millième
représentation de la
Fiancée vendue de Smetana, aucune
étude d'envergure. La moisson se
révélait bien maigre.
Une polémique réveilla les lecteurs de
la Revue
passionnés par la Tchécoslovaquie en 1928. Le
point de
départ fut la parution, en février, d'un papier
de Paul
Nettl, musicologue tchèque de culture allemande,
intitulé
"la musique en Bohême" dans lequel l'auteur
énonçait ses convictions : "Le musicien de
Bohême est avant tout virtuose populaire et virtuose
d'imitation.
[…] Ces manifestations (de l'art musical national) ont leur
racine dans la pure virtuosité et se rattachent à
la
musique du peuple dont elles sont sorties. […] Le
Tchèque
n'est pas par nature un moderne, un
“atonal”…" La
dernière phrase de l'article révélait
l'état d'esprit de son auteur : "Les Allemands de
Tchécoslovaquie devront absolument créer en
territoire
allemand un centre de ralliement artistique, s'ils ne veulent pas
sombrer dans l'alexandrinisme ou s'enliser dans un provincialisme
rétrograde." Cette affirmation ne pouvait que
claquer comme une
provocation pour les Tchèques. La réplique ne se
fit pas
attendre. Le compositeur K. B. Jirák s'en chargea en
mars :
"(M. Nettl) n'a pris la plume que pour discréditer et
rabaisser,
aux yeux de l'étranger, la musique tchèque. Et on
retrouve bien là la vieille méthode allemande qui
consiste à démontrer que tout ce qui n'est pas,
dans le
domaine de la science et de l'art germanique, ne possède
qu'une
valeur inférieure." Il poursuivit sa réponse par
un
vibrant éloge des compositeurs tchèques depuis
Smetana,
mais aussi des compositeurs bohêmiens et moraves du XVIIIe
siècle dans leur exode italien, français ou
allemand. Il
releva le propos de Paul Nettl qui "ne voit dans les festivals de
Prague que de la propagande pour la musique tchèque", propos
auquel il rétorqua : "Les Allemands de Bohême, et
particulièrement de Prague, ne sauraient se plaindre d'une
injustice. La section tchécoslovaque leur a
accordé un
groupe spécial avec leur jury propre qui choisit, de
façon indépendante, les compositions
destinées aux
festivals." On se trouvait un peu loin d'une étude
musicologique
et les lecteurs français peu au fait de la situation
politique
des pays tchèques, peu au fait de leur histoire, ne
pouvaient
pas comprendre que les enjeux artistiques rejoignaient les enjeux
politiques dans cette période de l'entre deux-guerres.
Quelques
années plus tard, les peuples tchèques
payèrent un
lourd tribut d'une situation que le nationalisme allemand
exacerbé par la victoire des nazis poussa à une
extrémité dramatique. Dans la revue, la musique
tchèque reprit ses
droits avec une note du correspondant londonien Dunton-Green saluant un
nouveau concerto
de Schulhoff. En octobre, on signala la parution d'un
disque du violoniste français Gabriel Bouillon
interprétant des Danses
slaves de
Dvořák. Janáček venait de
s'éteindre dans sa
Moravie. Nulle trace de sa disparition dans la Revue.
Et Janáček dans tout ça ?
A seize reprises, le lecteur attentif put trouver le nom
de Janáček suivi ou non d'informations plus ou
moins détaillées. Dès le
numéro
de
février 1922, une ligne signala un de ses
opéras sous le titre La
belle fille. Il s'agissait bien
sûr de Jenůfa.
Au mois de juin de cette même
année, les lecteurs prirent connaissance dans une nouvelle
note
rédigée par Fr. Grepl de la première
de Kata à
Brno (9 lignes). En août, le même
rédacteur
informait de l'exécution du Carnet d'un disparu
(4)
par neuf
nouvelles lignes qu'il qualifia par ces termes "le style, notamment
dans les éléments mélodiques,
résulte de la
recherche de l'expression populaire […] où il
puise
directement à la riche source musicale du langage et de la
musique moraves." Blanche
Selva, la pianiste française amie de Vincent d'Indy et de
Déodat de Séverac, qui professa de 1920
à 1924 au
conservatoire
de musique de Prague, et que rencontra au moins une fois
Janáček, fit paraître un article dans le
numéro du
1er juin 1923 sur la jeune école tchèque. Comme
il a
déjà été indiqué
plus haut, en
treize
pages, elle dressa un panorama quasiment complet de cette jeune
école tchèque. Après un bref
résumé
historique partant de la chanson populaire et aboutissant à
Smetana et Dvořák, elle aborda Janáček
dont elle
décrivit
les particularismes musicaux en dix-neuf lignes en
n'évoquant
que deux seuls ouvrages, Pastorkyna
(
Jenůfa) et
le cycle de mélodies, le Journal d'un disparu
(2). "Dans ces œuvres d'un caractère tout
à fait
particulier, il est arrivé à dégager
une intense
émotion avec des moyens fort simples, mais
émotion venant
du sens profond de la race et de ses modes de vie intérieure
et
extérieure." résuma-t-elle son sentiment
vis-à-vis
du maître morave. On peut s'étonner que
Blanche Selva, pianiste, ne parle point des ouvrages pour piano de
Janáček, alors que liée
à Václav Štĕpán
qui fut son élève à Paris, il lui
aurait
été possible de connaître Dans les brumes que
le pianiste tchèque joua en première audition
pragoise en 1922.
(4) La
traduction française propose tantôt Carnet d'un disparu,
tantôt Journal
d'un disparu pour Zápisník
zmizelého. Sous ces titres approchants, il
s'agit bien de la même œuvre.
Rendant compte du festival international de musique de Prague qui se
déroula du 25 mai au 7 juin,
festival organisé par
la section tchécoslovaque de la SIMC, en août
1924, le
compositeur tchèque K. B. Jirak mentionnait de nouveau Kata.
Même si cet écrit appartient à la
sphère
privée, il faut évoquer ici une lettre de Romain
Rolland
à Henry Prunières datée du 9 octobre
1924.
"Janáček est un grand musicien dramatique […] Je
ne vois
personne à lui comparer dans ce domaine, en Europe actuelle.
[…] Je n'ai pas le temps d'écrire un article sur
lui;
mais vous pourrez trouver dans un des meilleurs écrivains
germano-tchèques, Max Brod (Sternenhimmel)(5),
le récit
de la révélation que fut pour l'Autriche, pendant
la
guerre, la découverte de Janáček et la
première de
Jeji Pastorkyna."
Il est vraiment dommage que le grand écrivain Romain
Rolland, doublé d'un sens
aigu de
la musique, n'ait pas trouvé le temps d'écrire un
article pour La Revue musicale, comme il est regrettable que les
contacts entre cette revue et Max Brod n'aient pas abouti. Voir
distingué un compositeur tchèque par un
écrivain
français doublé d'un musicologue d'une telle
envergure ou
par un ami de Kafka aussi
perspicace que Max Brod aurait sans doute sonné les
débuts d'une
reconnaissance de Janáček en France. Encore un rendez-vous
manqué ! Cependant ce courrier du maître avec qui
il
continuait à partager l'intégrité de
ses
études aiguisa l'envie de Prunières.
(5) Le ciel
étoilé, chroniques
musicales et théâtrales de Max Brod, dont il a
été question un peu plus haut.
En 1925, le directeur de la revue entamait une
série
de trois
papiers. Le premier (en juin) s'attachait
à rendre compte du
festival de la SIMC organisé à Prague au cours
duquel
la Petite renarde
rusée fut
représentée dont il qualifia le compositeur du
titre du
"plus grand artiste tchèque depuis Smetana" et qui
fournit le sujet principal du deuxième papier en
août (une
page et
demie) dont sont extraits les deux passages qui suivent.
"Je dois dire tout d'abord
l'impression
d'étonnement que j'ai ressentie en découvrant
cette
musique absolument inconnue en France et dont la fraîcheur,
la
sincérité et l'accent de terroir vous frappent
dès
le premier contact. A Dieu ne plaise que je médise des
excellents musiciens qui composent aujourd'hui la jeune
école Tchèque. Je les connais et les
apprécie de
longue date, mais il y a entre eux et un Janacek toute la
différence qui sépare des artistes de grand
talent d'un
créateur de génie. Ce vieillard m'a paru
infiniment plus
jeunes que les adolescents dont on venait de me montrer les
œuvres… […]
Ce qui est prodigieux, dans cette partition, c'est l'invention
mélodique, c'est l'ingénuité de
l'inspiration.
L'orchestre sonne bien, l'écriture harmonique est fort
habile
(malgré l'abus des quintes augmentées). Le chant
consiste
en une déclamation très mélodique et
modelée sur la sonorité même des mots.
On pense
tout le temps à une sorte de Moussorgsky tchèque.
C'est
la même force persuasive, la même
spontanéité, la même
fraîcheur d'inspiration.
Je ne crois pas que Renard
soit le meilleur opéra de Janacek,
mais c'est assurément une des œuvres lyriques
modernes les
plus intéressantes et les plus vivantes que j'ai entendues
depuis vingt ans. Quand se décidera-t-on à
révéler en France les œuvres du
dramaturge
tchèque ?"
Malgré ses souhaits, Henry Prunières, que la mort
surprit
en 1942, ne vit jamais cet opéra
de Janáček sur une
scène française, ni d'ailleurs aucun de ses neuf
autres opéras. Et ses compatriotes durent attendre 1957
pour le découvrir dirigé
par Vaclav Neumann dans la version de Felsenstein produite par le
Komische Oper de Berlin, opéra
importé à Paris dans le cadre du
Théâtre des Nations…
Revenons à la revue. En octobre de cette
année 1925, le même rédacteur
présent au festival international ultérieur,
cette
fois-ci à Venise, traça à travers les
œuvres
entendues les grandes lignes de la musique vivante. Le talent du
compositeur morave s'enrichit de son premier quatuor
à cordes.
"La
Tchéco-Slovaquie triompha
une fois de plus, grâce au vieux maître Janacek,
dont la
verdeur fut pour tous une cause nouvelle d'admiration. Rien de plus
frais et de plus délicieusement spontané que ce
quatuor
qu'il faut souhaiter entendre bientôt jouer à
Paris." (6)
(6) Quatuor
interprété à Paris par le Quatuor de
Prague en 1931.
La reconnaissance de Janáček survint avec le
numéro du mois d'août
1926 qui s'ouvrait par un article de onze pages exclusivement
consacré au maître morave, écrit par le
musicologue Erwin Felber, article sur lequel il convient de nous
étendre. Honneur insigne, un bois gravé
représentait sur une pleine page le compositeur de Brno
alors
que le supplément de la revue offrait la partition de deux
des
pièces composant Rikadla,
première version (numérotée
à son catalogue
V/16). Le compositeur vivant ses
dernières années oh combien créatives,
le lectorat
musical français de cette revue en connaissait ainsi
l'existence. On reste ébahi devant la clairvoyance du
musicologue et sa connaissance du corpus compositionnel de
Janáček. S'il n'eut pas l'opportunité d'assister
à
l'exécution de toutes les œuvres qu'il cite, il
eut
l'honnêteté de ne pas se fier aux rumeurs, mais,
afin de
se faire sa propre opinion, de parcourir les partitions de ces
ouvrages. Il rencontra le compositeur et la lecture de son
papier indique qu'elle ne fut pas quelconque, mais féconde
et
qu'il sut saisir les particularités de l'âme du
maître morave dont on sait qu'il n'appréciait ni
les
longs discours, ni les longs entretiens. Dans son papier, il
commença par qualifier
Janáček (âgé de soixante-dix ans) de
travailleur
infatigable, "indulgent au monde, impitoyable envers
soi-même."
Il découvrit sa musique "avec sa tendresse intime et sa
rudesse
extérieure" et dépista les
préoccupations
artistiques du musicien en le citant "Tout homme de qui j'ai pu saisir
la mélodie de sa parole me permet de lire plus
profondément dans son âme." Plusieurs fois,
il
compara son importance de théoricien à celle de
Schoenberg ! Il évoqua trois opéras,
Jenůfa, Kát'a
Kabanová et la Petite renarde rusée."
Dans Jenufa, Moussorgski
et Debussy se rencontrent ; la finesse debussyste est
transplantée en un plus robuste terrain slave." Il dressa
ensuite une courte biographie qui, même entachée
d'erreurs bénignes de date, éclaira le lecteur
sur les
origines et le parcours du compositeur. Il établit une liste
relativement complète des travaux du maître morave
en les
commentant brièvement, les opéras non encore
représentés tels Sarka et le Destin ; le Journal d'un disparu,
les pièces pianistiques, Sur un sentier recouvert,
Dans les brumes
; les principaux chœurs, les
70000, Marycka
Magdonova, la
Légion tchèque, le Fou errant ; des
mélodies, les Chansons
de Hradcany, le Quatuor à cordes "sonate à Kreutzer",
le sextuor pour vents "Jeunesse"
; les poèmes symphoniques Taras Bulba, Ballade de Blanik, l'Enfant du violoneux,
la sonate pour violoncelle "Un
Conte", la sonate pour piano en deux mouvements, la
cantate Amarus
et l'Eternel
évangile.
"C'est à lui
que s'appliquent
les mots dont il a caractérisé Dvorak
”Son
intelligence était d'une nature toute
particulière ; il
ne pensait qu'en sons et n'avait nul autre souci.” Il est un
Moussorgski slovaque, un maître de la technique, un
génie
de l'inspiration, un constructeur de talent que n'aveugle pas la
virtuosité, un artiste puissant par l'expression, qui a su
tirer
parti de l'impressionnisme, rude d'aspect, une nature de lutteur, et
pourtant d'une extrême bonté ; silencieux et
pénétré, l'homme des violents
contrastes qui se
résolvent en harmonie. Solitaire, puissant,
étranger aux
fausses apparences d'une civilisation lassée, il n'a nul
besoin
de gémir, comme le poète suisse Gottfried Keller
dans ses
Ghazels :
”Notre lot est
celui des épigones.” Mais bien plutôt il
peut dire
avec joie : ”La recherche fut le but de toute ma
vie.”
(Erwin Felber)
 Bois gravé de
Jean Lebedeff
Bois gravé de
Jean Lebedeff (paru en août 1926 dans la Revue
Musicale)
montage photographique
Parions que, si le
Sacre du printemps avait
été créé dans son pays
d'origine, la
"révolution" stravinskienne n'aurait probablement pas
touché avec
l'ampleur qu'on lui connut les milieux musicaux européens.
Si
Janáček avait compris qu'une présence sur le sol
français était indispensable pour percer et s'il
s'était donné les moyens pour le
réaliser,
l'histoire de la musique occidentale en aurait
été -
peut-être - quelque peu modifiée ! Mais
Janáček,
l'homme, serait-il resté celui que nous connaissons
?
En juin 1927, André Coeuroy signa dans une note de la partie
"l'édition musicale" dédiée
à Vec
Makropoulos qui venait de paraître chez
Universal le texte
suivant :
"La pièce de
Capek, l'Affaire
Makropoulos, bien connue en Europe centrale, a
été mise
en musique par Janacek avec une verve que la vieillesse laisse intacte.
L'abondance et la vigueur de la “mélodie
parlée” y sont remarquables : dès la
première scène apparaissent des récits
dont les
détails rythmiques ne sont pas notés, mais qui
doivent
être créés par le chanteur
lui-même dans
l'espace d'une ou deux mesures, selon le rythme de la phrase
poétique, sur une note dont la hauteur est
indiquée par
une ronde. La clarté de l'écriture
transparaît dans
la réduction pour piano de Ludwik Kundera.(7)"
(7)
père de l'écrivain tchèque Milan
Kundera
Retrouvons Henry Prunières au
festival annuel de la
SIMC à Francfort dont il assurait la couverture. Extrayons
ce
passage (septembre 1927) :
"J'allais
oublier le Concertino
pour piano, deux violons, alto, clarinette, cor de basson de Leo
Janacek. Ce n'est sans doute pas une des meilleures compositions du
maître tchèque, mais ce musicien ne saurait rien
écrire d'indifférent. Il y a des trouvailles
charmantes
dans ce Concertino,
des pages d'une fraîcheur et d'une
spontanéité délicieuses."
Dans la rubrique "les revues et la presse" en novembre 1927, on trouve
une nouvelle et brève mention signalant la
représentation de Vec
Makropoulos (l'Affaire Makropoulos) à Prague.
Janáček vivait ses derniers mois de créateur. En
janvier,
une chronique de Vomáčka parlait des derniers ouvrages de
Suda
(de neuf ans plus âgé que Suk) et Burian
(né
après 1900). André Cœuroy
présentait "les
nouveaux visages de l'opéra" où il argumentait
ainsi
: "L'expérience montre que les seuls opéras
originaux sont
ceux qui décèlent une recherche de
déclamation
conforme au langage. En ce sens on peut dire qu'il ne peut plus y avoir
d'opéra que s'il est national, non dans son sujet mais dans
sa
volonté esthétique. Se libérer du
“dialecte
d'opéra” c'est le seul effort qui soit digne de
cette
forme, et c'est aussi à quoi se sont attachés les
musiciens conscients de cette nécessité :
Moussorgski
avec Boris,
Debussy avec Pelléas,
Bartok avec le Château
de Barbe-Bleue, Janacek avec ses drames moraves,
Szymanowski avec le Roi
Roger, Honegger avec Antigone."
Le moins qu'on puisse dire c'est que le musicologue ne faisait pas
preuve de cécité en dressant une telle liste et
que,
probablement, Janáček n'aurait pas
désavoué pareille compagnie ! En
février et en
mars, il fallait lire plus qu'attentivement la revue et fouiller chaque
recoin de page pour apercevoir par trois fois le nom du compositeur
morave et rien d'autre. Tout était dit.
B) de 1928
à 1939
Sa
disparition en août 1928 ne fut pourtant
pas immédiatement saluée. Il fallut
attendre le mois de juillet de l'année suivante pour qu'un
article décevant saluât la mémoire de
Janáček.
Pourquoi, alors qu'Erwin Felber en 1926 avait fort bien compris les
caractéristiques du style musical du compositeur morave,
avoir
confié à un musicologue peu au fait de cette
musique et
si peu en phase avec elle, le soin de rédiger cet hommage
funèbre ? A lire la manière évasive
dont le
rédacteur évoquait un certain nombre
d'œuvres qu'il
citait, il était évident qu'il ne les avait
jamais
entendues. Tout son exposé se réfugiait dans des
formules
vagues. Il se contentait d'énumérer les ouvrages
du
maître de Brno et lorsqu'il s'étendait quelque peu
sur
l'une d'entre elles, il tombait aisément dans des
contresens.
Ainsi assimiler la Petite
Renarde rusée à
une forme d'opéra-comique traduisait une perception
faussée ou pour le moins simpliste de cet opéra.
Ainsi encore après avoir
affirmé que "l'instrumentation de ces œuvres
[symphoniques] est vraiment très personnelle" comment
pouvait-il
ajouter "Cette instrumentation est basée sur celle
de Dvořák" sans s'apercevoir de la contradiction ?
Le
lecteur de bonne foi prenant connaissance de cette rubrique
nécrologique ne pouvait, sa lecture terminée,
que rester dubitatif. Cet article ressemblait à un coup
d'épée dans
l'eau ! Janáček méritait mieux.
Pendant la décennie qui suivit la disparition de
Janáček,
le rythme de parution d'articles dédiés
à
la musique tchèque se ralentit : 41 notices allant
de
quelques lignes à plusieurs pages c'est-à-dire le
même nombre que dans la période
précédente
pourtant plus courte de 3 ans. Le grand vainqueur est
incontestablement Martinů. Il jouissait d'un triple avantage :
d'être fixé en France depuis 1923,
d'être partie
prenante de sociétés musicales telle Triton qui
ne
ménagèrent pas leurs efforts pour diffuser sa
musique (8), de
paraître aux oreilles du public moins exotique que ses
compatriotes restés au pays en ayant assimilé
beaucoup
plus facilement les influences de la musique française de
cette
époque. Et comme c'était un compositeur
prolixe,
les occasions de puiser dans ses compositions étaient
nombreuses. Toutes ces particularités n'enlevaient rien
à
son grand talent et à l'indéniable
séduction qui
se dégageait de sa musique. Dans le numéro de
septembre-octobre 1934 de sa revue, Henry Prunières
déclarait "Un de ces jeunes est déjà
célèbre […] c'est Martinu, que je
considère, pour ma part, comme le plus brillant
représentant de l'école tchèque
contemporaine.
Musicien original qui s'est dégagé assez vite de
l'influence de Stravinsky et dont la qualité
éminente est
la vie. […] Tout ce qu'il fait est doué de
mouvement et
d'expression. Il y prodigue une vive sensibilité rythmique
et
polyphonique, en digne successeur du grand Leos Janacek." Tout au long
de ces années, nombre de ses œuvres furent
commentées dans les pages de la Revue. On se
contentera de
les lister : Duo
pour violon et violoncelle, Quintette
pour deux violons, deux altos et violoncelle en 1929, Allegro symphonique,
la Revue de cuisine,
un Quintette
en 1930, Quatuor
à cordes n° 3, Quatuor
avec orchestre en 1932, Danses
tchèques pour piano, Sonate pour violon
et piano n° 2, Trio,
en 1933, un Quatuor
en 1934, un Concerto
en 1936, les Jeux de
Marie, un Trio
pour piano et cordes, en 1937, la Revue
de cuisine
et deux pièces pour clavecin en 1938. Le lecteur
intéressé pourra consulter le site www.martinu.cz
(en
tchèque et en anglais), une véritable mine
d'informations
et un site français attachant http://patachonf.free.fr/musique/martinu/
où le catalogue (en français) des
œuvres du
compositeur peut être consulté.
(8) La
société
Triton assura sept créations de Martinů entre 1932, date de
sa
fondation et 1939, fin de son existence.
Pour le reste de la musique tchèque, délaissons
les brèves, où les
seules mentions d'un titre d'œuvre et/ou du nom d'un
compositeur n'étanchent pas notre soif
d'informations.
Relevons d'abord, dans le numéro du mois de janvier 1929,
sous
la signature d'André Coeuroy la relation de la
création
de la
Fiancée vendue
de Smetana, premier opéra tchèque à
être
monté en France et toujours par le même
rédacteur
le compte-rendu d'un concert de musique tchécoslovaque
donné à l'Ecole Normale de Musique sous le
patronage de
l'ambassadeur de la République tchécoslovaque
avec des
ouvrages de Smetana, Novák, Dvořák, Suk et
Martinů,
concert précédé d'une causerie
d'Etienne Fournol,
collaborateur de la Revue.
Attachons-nous à une entreprise originale initiée
par la
Revue en 1931 : dresser une géographie musicale de l'Europe.
Probus (j'ignore qui se cache derrière ce pseudonyme
emprunté
au nom d'un empereur romain du IIIe siècle) peignit un
tableau
de la situation musicale tchèque au tournant des
années
30 qu'il nous faut étudier. Il passa en revue les
compositeurs
tchèques vivant en 1930 avec une notable exception, la
présence de Janáček disparu deux ans plus
tôt.
Pourquoi cette anomalie ? Très justement, l'auteur inscrivit
le
compositeur morave parmi les pères de cette école
musicale tchèque moderne, même si
lui-même n'eut pas
d'élève prêt à continuer
dans sa voie.
"Janáček, on peut le dire sans exagération, est
resté à l'abri de toute influence venue soit de
l'étranger, soit du pays. Le folklore national, dans lequel
il
n'a cessé de puiser jusqu'à la fin de sa vie, lui
offrait
une base solide. Ils s'étaient (sic) en outre
constitué
une méthode, celle des “notices
musicales” dans
lesquelles il enregistrait la parole, le chant des oiseaux, et les
bruits les plus divers de la nature. Tout cela, joint au
caractère de l'artiste, aussi rude que passionné,
explique la grandeur de son art." Il passa ensuite en revue la
production de Josef Suk, de Vítĕzslav Novák, de
J.B
Foerster et de ses deux disciples Otakar Ostrčil et Otakar
Zich.
Puis vinrent Rudolf Karel et Jaroslav Křička. Le rédacteur
s'attacha ensuite à dépeindre la "jeune
génération des musiciens
tchécoslovaques, celle
dont la production date d'après-guerre [qui] a
trouvé
dans le nouvel Etat des conditions tout autres, plus favorables que la
génération [précédente]"
S'en suivit une
liste de compositeurs dans laquelle nous retrouvons des noms
déjà mentionnés dans des chroniques
antérieures et en découvrons d'autres : Ladislas
Vycpalek, Bohuslav Martinů qui
bénéficia de quasiment deux pages, Otakar
Jeremiáš, Karel Boleslav Jirák,
Václav
Štĕpán, Boleslav Vomáčka, Emile Axman,
F. Mandič
cité brièvement, Aloïs Hába.
Il termina son
tour d'horizon par un bref regard sur "l'Ecole de Brno" avec Jan Kunc,
Vílem Petrželka, Václav Kaprál,
Jaroslav Kvapil et
Oswald Chlubna, et donna une dernière liste de jeunes
compositeurs : J. Hüttel, Jan Zelinka, Jaroslav Ridky,
František Picha, E.T. Burian, Isa Krejčí et
Jaroslav
Ježek à laquelle il ajouta les noms de musiciens de
Bratislava,
A. Moyses, Vladimir Meličko. Nous n'avons pas jugé utile
d'adjoindre à chaque compositeur de cette
énumération la liste des œuvres pour
chacun d'entre
eux telles qu'indiquées par le rédacteur.
D'autant plus
qu'elle se monte à environ 150. Ce chiffre exprime bien la
vitalité de cette école.
En dehors d'une relative popularité
(surtout parisienne) de Martinů pour les raisons que j'ai
exposées un peu plus haut, que l'on se souvienne que la
musique
de Janáček n'eut droit de cité en France
que six
fois entre 1929 et 1938 et que celle de la plupart de ses compatriotes
ne bénéficia que de rares exécutions
dues plus
à la bonne volonté d'associations ou d'organismes
artistiques (les Mardis de la Revue Musicale, les concerts Triton, les
concerts de l'Ecole Normale de Musique) qu'à celle,
quasiment inexistante, des grandes associations de concerts (Colonne,
Lamoureux, Concerts du conservatoire…). Que nous inspire
maintenant cette exubérante création musicale
tchèque des années 30 ? Si l'on exclut
Janáček et
Martinů de ce relevé, quel mélomane peut se
targuer
d'avoir entendu actuellement dans les salles de concert
françaises une
pièce de l'un de ces musiciens
tchèques ? Et
à moins de se procurer des disques directement en
république tchèque, qui a eu l'occasion de
repérer
un enregistrement de ces compositeurs en fouillant dans les bacs des
disquaires ?
L'une des rares incursions des grandes associations de concerts dans la
musique tchèque eut lieu chez Lamoureux au début
de 1930
avec Les fins
dernières de l'homme,
une cantate pour soprano, baryton et chœur de Ladislav
Vycpalek
relatée dans la Revue Musicale du mois de mars par un
rédacteur anonyme. Il faut croire que l'œuvre fit
une
certaine impression puisqu'on lui consacra quasiment deux pages et
même si la critique parut rugueuse. "Le texte, tel qu'il se
présente, est sans aucun doute un point de départ
puissant et plein de ressources. Au musicien d'en faire un chef
d'œuvre. L'ouvrage de M. Vycpalek malheureusement, est loin
d'en
être un. Encore que le début aux harmonies dures
et d'un
archaïsme persuasif nous promette l'ampleur et une
rigidité
impressionnante, nous sommes bientôt
déçus par une
grisaille scholastique, un tissu contrapuntique par trop compact, sans
air ni couleur, ni dynamisme inhérent."
Au cours de ses pérégrinations en Europe
Centrale, s'il
s'était déjà rendu plusieurs fois
à Prague,
Henry Prunières n'avait jamais visité Brno. Il y
salua la
mémoire du maître morave dans le numéro
du mois de
mars de l'année 1933. "A Brno, patrie de Janaček, les
opéras de ce dernier sont donnés avec un soin
minutieux
et, à ce qu'on m'a assuré, mieux même
qu'à
Prague. J'ai bien regretté de ne pouvoir m'en rendre compte
par
moi-même." Il y releva "l'inventaire
détaillé des
bibliothèques et archives musicales des châteaux
et des
villes de la Moravie" sous la direction du musicologue Vladimir Helfert.
Atteignons maintenant l'année 1934 et le numéro
142. Sous la plume de Louis
Grein, dit Dunton-Green, correspondant à Londres, on put
lire : " Robert Hegar, de Vienne, qui dirigea fort
sainement au concert du Courtauld-Sargent Club, nous apporta une
Sinfonietta
de Janáček dont la charmante originalité
d'invention et de structure pouvait, à 72 ans, rivaliser
avec
les tout jeunes." Parcourons dans le numéro 145, d'avril de
cette même année, l'article d'Arthur
Hoerée
intitulé "Renaissance du chant choral dans l'œuvre
symphonique". Un large balayage historique était
opéré
où se distinguaient les œuvres religieuses
d'Hændel,
Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Bruckner et Franck pour les
siècles passés. Pour le siècle
présent,
l'inventaire relevait Debussy avec ses Sirènes
extraites
des Nocturnes,
Daphnis et Chloë
de Ravel, le Psaume
XLVII de
Florent Schmitt, le Roi
David d'Arthur Honegger, le Miroir de
Jésus d'André Caplet, le Psaume hongrois de
Kodaly, la
Symphonie des psaumes
de Stravinsky, le Stabat
mater de Szymanowsky
ainsi que des pièces d'Holst, de Vaughan-Williams et
d'Hindemith. Soit un tour d'horizon fort bien documenté
d'où aucune œuvre marquante ne semblait exclue.
Sauf la
Messe glagolitique,
exacte contemporaine du Stabat
mater du
compositeur
polonais de la ligne au-dessus et dans laquelle le chant choral se
taille une place forte. Pourquoi cet oubli ? Mais faut-il l'appeler
oubli ou parier sur la méconnaissance ? Dans ce cas,
l'honnêteté de l'auteur mériterait
d'être
soulignée, plutôt ignorer cette Messe que d'en
parler par ouï-dire. Décidément, la
distance
paraissait bien grande entre Paris et la Tchécoslovaquie
pour
qu'une œuvre majeure comme celle-ci soit inconnue des
décideurs
artistiques plusieurs
centaines de kilomètres plus loin …
Changeons d'année. Dans le numéro 154
daté de mars
1935, la compositrice Suzanne Demarquez rendit compte d'un concert
organisé par la société Triton (9), le
15
février dernier, dans la salle de l'Ecole Normale de Musique
consacré à la musique tchèque. Nous
apprenons
qu'un ensemble de sonates pour violon et piano y est donné,
mais
ni celle de Jaroslav Ježek, (orthographié Jesek) ni celle de
Jaroslav Křička ne trouvent
vraiment grâce auprès de la signataire de la note
avec une
nuance de bienveillance pour la seconde, pas plus que l'Intermezzo
lyrique de Jirák, ni que les pages de
Vycpalek, Vomáčka, Hippmann. Par
contre le trio
à cordes du jeune Martinů
interprété par le Trio Pasquier paraît
plein de
promesses. A ce concert, figurait également, en
première
audition française, la Sonate
pour violon et piano
de
Janáček. Comment fut-elle reçue ? Si l'on en juge
par la
brève annotation de Suzanne Demarquez, dans une
indifférence
polie. "Suivant l’ordre chronologique j’aurais
dû
mentionner en premier lieu la
Sonate violon et piano de Janáček, datant de 1914.
“Dater” est
d’ailleurs le mot juste pour cette œuvre
à sentimentalisme
et aux
fausses basses à la Lekeu." Un tel commentaire
n'encourageait en
rien le lecteur à porter une oreille attentive à
ce
compositeur si par hasard une autre de ces pièces
était
présentée… Parmi les
interprètes,
relevons la présence de la pianiste Germaine Leroux qui se
dévoua tant pour faire connaître la musique
tchèque. L'opinion du compositeur Georges Dandelot permit de
nuancer
ce premier jugement : "Robert Soëtens, magnifique violoniste,
et
Mlle Germaine Leroux, donnèrent en outre une
interprétation chaleureuse de la Sonate
de Janáček, œuvre riche, d'un lyrisme
assez voisin de
celui de Guillaume Lekeu, mais beaucoup plus
équilibré et
composé." Dans la même livraison de la Revue,
remarquons la "Lettre de
Prague" signée de Gerth Baruch dont voici un
extrait :
"La
dernière saison fut marquée par plusieurs
jubilés.
La scène principale, le Théâtre
National
Tchèque, célébra le
cinquantième
anniversaire de son existence et honora les compositeurs
Suk, Dvořák,
Smetana et Janáček. Parmi ces
festivités, il y eut
la représentation scénique de
l’oratorio Sainte
Ludmilla de Dvorak, et l’opéra
posthume
de Janáček, la
Maison des morts,
dans une reprise
très applaudie. […] Les programmes de concerts
pour
chœurs furent pleins d’ouvrages rarement
représentés. […] Les Institutrices de
Prague
choisirent des chœurs intéressants
de Janáček,
…"
(9) La
société
Triton, dont le comité directeur regroupait Honegger,
Milhaud,
Ibert, Rivier, Tomasi, Ferroud, Harsanyi, Mihalovici et Prokofiev mit
sur pied des séries de concerts de musique de chambre de
1932
à 1939 offrant une largesse d'esprit relativement rare dans
le
Paris de cette époque pour programmer en plus des
œuvres
de ses sociétaires des musiciens étrangers
comme le Suisse Conrad Beck, Erwin Schulhoff, Bohuslav Martinů,
Alexandre Tasman, Arthur Lourié, Alexandre Tcherepnine ou
plus
connus, ainsi Paul Hindemith, Georges Enesco et Bela Bartok.

En mai 1940, une réunion de musiciens à la
terrasse d'un café parisien
(Tibor Harsanyi, Georges Auric, Pierre Bernac, Marcel Mihalovici,
Francis Poulenc, Alexandre Tcherepnine et son épouse,
Alexandre Tansman, Bohuslav et Charlotte Martinů…)
© Musée municipal de Policka - Mémorial
Bohuslav Martinů -
www.muzeum.policka.net
En 1936, le compositeur d'origine roumaine, Marcel Mihalovici qui
s'était
rendu en avril à Barcelone au 14è festival de la
SIMC remarqua
des Berceuses
de Václav Kaprál,
un des musiciens partie
prenante du Club des compositeurs moraves que présida un
temps
Janáček. En juillet-août, un jury
composé d'Albert
Roussel, Jacques Ibert, Pierre-Octave Ferroud et Darius Milhaud
décernait le Prix de la Revue Musicale pour la meilleure
sérénade pour instruments à vents
à un
membre de l'Ecole de Brno, le compositeur Theodor Schaefer. En
décembre, un article posthume du jeune compositeur
français Pierre-Octave Ferroud (il trouva la mort
à
trente-six ans dans un
accident de la circulation sur les routes de Hongrie)
proclamait
son intérêt pour la musique de
Bohuslav Martinů. Son sous-titre donnait le ton "Un grand
musicien
d'aujourd'hui". Parmi ces cinq pages, relevons deux points :
"Le caractère
effacé d'un
Bohuslav Martinu ne doit point nous induire en erreur. Si l'on
soulève, en effet, le masque de douleur grâce
auquel il
évite peut-être des promiscuités qui
lui
répugnerait, l'on est forcé de convenir que
l'artiste qui
s'abrite derrière ce faible rempart est non seulement l'un
des
plus complets, à tenir compte simplement du volume de son
bagage, mais aussi l'un des plus originaux de notre temps.
Enfin, insistons sur ce dernier point, cette musique saine et joyeuse
s'appuie sur un élément fondamental qui est comme
une
essence du folklore, sans jamais un emprunt au moindre thème
populaire, mais avec d'incessantes allusions qui lui
confèrent
tour à tour son caractère piquant ou son
authenticité. Il faut bien le répéter
; les
classiques, Mozart en particulier, n'en ont jamais usé
autrement, et c'est probablement pour cette raison que le
thème
apparemment le plus innocent du petit Salzbourgeois évoque
aussitôt, en nous, en n'importe qui, un écho qui
résonne jusqu'au tréfonds de l'âme."
Martinů élève à Paris
d'Albert Roussel. Les
échanges tchéco-français
s'inversèrent
parfois. Julia Reisserova, autre élève d'Albert
Roussel,
joua sans doute un rôle déterminant dans la
création tchèque à Olomouc,
en Moravie, d'une
comédie musicale de son maître
français, le Testament
de Tante Caroline, occasion d'un billet dans les colonnes
de la Revue, ce même mois de décembre 1936.
Début 1937, la revue donna la relation
d'un concert des
mardis musicaux qu'elle organisait régulièrement,
concert
entièrement dédié à la
musique
tchèque avec des œuvres
de Vítĕzslav
Novák, Boleslav Vomáčka, Karel
Boleslav
Jirák,
Bohuslav Martinů
et Julia Reisserova, une compositrice qui prolongea dans les
années 20 ses études
musicales en France auprès d'Albert Roussel et de Nadia
Boulanger, comme nous l'avons déjà
indiqué. Le mois suivant, de Prague, Gerth Baruch envoyait
ses
impressions positives à propos de la première
audition
des Jeux de Marie
de Bohuslav Martinů, basé sur "quatre contes relatifs
à
la Sainte Vierge. […] La psalmodie archaïque du
mythe
initial contraste avec le mouvement rythmique et dramatique de
l'épisode de la Rédemption, de même que
la suave
idylle de Noël, toute imprégnée d'une
atmosphère nationale, s'oppose avec bonheur au dernier
tableau
qui, lui aussi, est d'essence dramatique."
Un peu plus loin dans les pages de ce numéro de la Revue,
Arthur
Hoérée étudiait la partition du Journal d'un disparu
de Janáček que le rédacteur s'était
procuré
auprès de l'éditeur Pazdirek de Brno. Il en
rappelait la
première audition à un concert de la
société Triton l'année
précédente.
Ce en quoi il se trompait puisque Mischa-Leon l'avait chanté
à Paris en 1922. Il faut bien croire que cette
première
audition par le ténor danois avait été
donnée devant un auditoire confidentiel puisque elle
était passée inaperçue pour des
musicologues
pourtant attentifs à la nouveauté. Toujours
est-il
qu'Hoérée en relevait l'originalité.
"On est
frappé, dès l'abord par la dualité du
style vocal.
D'une part une tessiture moyenne et son contour très proche
de
la chanson populaire ou du moins, du lied. D'autre part, des
envolées lyriques dans le registre aigu et l'accent
théâtral. […] Le langage harmonique, de
Janacek si
libre soit-il, répond d'ailleurs à une logique
intérieure qui est la marque de l'innovation
véritable
à l'opposé de l'exploitation d'une formule
fabriquée par système." Après avoir
relevé
des traces d'influence sans doute fortuite de Brahms et Debussy, il
détaillait les différents chants de cette
partition : "Le
quatrième poème avec sa fine arabesque construite
en
canon est des plus significatives à ce point de vue.
Signalons
encore le rythme puissant du n° 6, le mystère du
n° 12,
évoquant dans un cadre de sous-bois l'envoûtement
que
provoque la tzigane ; voici encore la belle plainte du
quatrième
poème, le contour assez slave du neuvième,
l'élan
impulsif du finale." Il terminait son étude en souhaitant
que
Mme Leroux (10) qui officiait au concert de Triton donne une nouvelle
audition de "cette œuvre d'un grand
intérêt."
(10) Germaine
Leroux, pianiste
française, se dévoua pour les ouvrages de
Janáček
et de Martinů avec qui elle se lia d'autant plus facilement que son
mari, le diplomate tchèque féru de musique, Milos
Safranek, était déjà ami de
Martinů. Il
réalisa durant les années de guerre la
première
biographie de son compatriote.
 La pianiste Germaine
Leroux
La pianiste Germaine
Leroux
en compagnie de Bohuslav Martinů (à droite) et du chef Leon
Barzin (1942)
© Musée municipal de Policka - Mémorial
Bohuslav Martinů -
www.muzeum.policka.net
L'année suivante, dans la programmation du prochain festival
de la
SIMC à
Londres au mois de juin, on releva la Sinfonietta de
la toute jeune et prometteuse
Vítĕzslava Kaprálová (11), la
propre fille
de
Václav Kaprál dont il a
été question
plus haut, un
quatuor de
Viktor Ullmann, des mélodies avec accompagnement d'un
quintette
à vent de Isa Krejčí et la Musique pour
radio de
František
Bartoš (l'homonyme du compagnon de collectes de musique
populaire
de Janáček). Dans ce numéro de janvier,
Peter
Gradenwitz rédigea une assez longue étude sur
"Johan
Stamitz - remarquons la germanisation du nom - et le petit
prophète de Boehmisschbreda".
(11) Le
Studio Matous a
rendu hommage en 1998 à cette compositrice par un disque
entier
consacré à plusieurs de ses œuvres et
notamment
à cette Sinfonietta ("Portrait of the composer" MK 0049 -
2011)
et en 2003 Supraphon a confié à la soprano Dana
Burešová et au musicologue et pianiste Timothy
Cheek le
soin de proposer un enregistrement de ses mélodies (SU
3752-2
231).
C'est sous le titre "Témoignage tchécoslovaque"
qu'en
novembre 1937, Bohuslav Martinů rendait hommage à son
maître Albert Roussel qui venait de disparaître.
"Tout ce que je suis venu
chercher
à Paris, je l'ai trouvé chez lui et de plus son
amitié a été le plus
précieux des
réconforts. Ce que je suis venu chercher chez lui,
c'était l'ordre, la clarté, la mesure, le
goût et
l'expression directe et sensible, les qualités de l'art
français que j'ai toujours admiré et que j'ai
voulu
connaître plus intimement. Toutes ces qualités, il
les
avait et il m'avait fait part généreusement de
son
savoir, très simplement et très naturellement, en
grand
artiste qu'il était. J'ai été son
élève, et grâce à cela, je
me sens un peu
Français et j'en suis très fier et aussi
j'espère
bien un jour transmettre son message chez nous, à Prague,
où il est si admiré."
Point besoin n'est de s'étendre sur les relations musicales
d'alors entre la France et la Tchécoslovaquie, les propos
de Martinů étant suffisamment éloquents.
On attendit le
numéro 186 de septembre-novembre 1938 pour retrouver trace
de
Janáček dans une note à propos du festival de
musique de
chambre de Trencianske Teplice, petite station thermale dans la
vallée du Vah en Slovaquie, proche de la ville de Trencin,
à quelques kilomètres seulement de la Moravie.
"La
musique
tchèque y était représentée
par treize
œuvres bien choisies dont trois de Janáček."
Franchissons
une nouvelle année. Dans le numéro 189 du mois de
mars
1939, dans la copieuse revue de presse, une
énumération
des articles publiés en France et à
l'étranger, on
découvrait la mention dans la revue tchèque
Hudebni
Vychova
(Enseignement de la musique) d'un écrit de Jan Racek (12)
"Janackovo
moravstvi"que l'on pourrait traduire par "Janáček morave".
(12) Vous
trouverez sur ce site
un article de Jan Racek se rapportant à l'impressionnisme
dans
la musique de Janáček
La Revue Musicale symbolise assez bien l'état des relations
entre le public éclairé constitué par
les
compositeurs et critiques musicaux que la musique moderne ne rebutait
pas et
Janáček. Au pire, une méconnaissance
complète du
compositeur morave, au mieux une incompréhension et parfois
un
intérêt qui ne dépassait pas les bonnes
intentions
et
n'allait pas jusqu'à l'engagement et ceci quelques
soient les
qualités que lui trouvaient quelques rares
personnalités telles Henry Prunières, Erwin
Felber
ou Arthur Hoérée. Quant à
l'enthousiasme,
n'en parlons pas ! Retenons plutôt la prudence pour
ménager l'avenir. Dans
l'entre-deux-guerres, ce compositeur morave dérangeait,
agaçait,
intriguait. Ne se rattachant ni au sérialisme, ni
à
l'impressionnisme, ni à l'expressionnisme, ni au
néoclassicisme, ni au dandysme
musical, ni à aucune autre école, comment le
peser,
l'appréhender ? Les clés ne se
trouvaient pas en
possession de la plupart de nos compatriotes. On ne pouvait
même
pas y retrouver le charme, l'exotisme, la verdeur, la candeur de la
musique folklorique de l'Europe centrale.
Décidément, ce
compositeur inclassable brouillait les pistes. Et peu de
mélomanes avaient envie de suivre le sentier les emmenant
dans
des contrées leur paraissant inhospitalières.
Quel manque
de curiosité, quelle frilosité ! Que ne
s'appliquaient-ils pas la remarque pleine de
vérité - et
qui pourrait concerner tout à fait nos pratiques musicales
contemporaines - que Robert Bernard écrivait en janvier 1936
"le
concert est en passe de devenir un cimetière où
l'on va
déposer des fleurs devant des sépultures
aimées".
Résumons-nous, le temps de Janáček
n'était pas
encore venu !
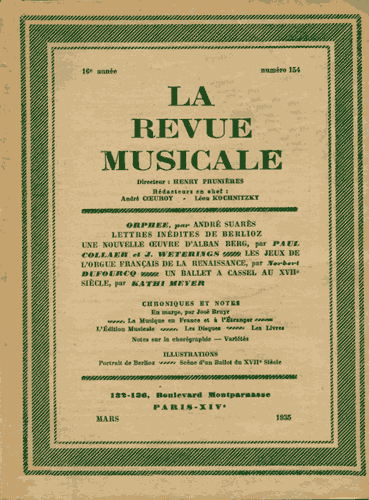
Couverture de LA REVUE MUSICALE, numéro 154, mars 1935
C) après 1940
Bien qu'elle
réussit à
produire trois numéros au début de 1940, la Revue
Musicale interrompit sa publication pendant les
années de
guerre et ne reprit épisodiquement qu'en 1946. Suite aux
grandes
difficultés économiques de l'après
conflit, elle
connut une existence éphémère (onze
numéros
en 1946/47, un seul en 1949) avant de reprendre un cycle
régulier à partir de 1952, date à
laquelle les
Editions Richard-Masse (en fait surtout Albert Richard) la reprirent en
main. Cependant la composition
de la revue évolua radicalement vers une suite de
numéros spéciaux allant jusqu'à
occuper trois
voire quatre numéros pour une seule livraison traitant d'un
thème précis, la plupart du temps unique, tel par
exemple, la littérature française et la musique,
Erik
Satie et son temps (1952), la musique polonaise d'aujourd'hui (1953),
les deux Passions de J.S. Bach (1955), Mozart (1956, bicentenaire de sa
naissance), Berlioz, le concours M. Long - J. Thibaud (1959), I.
Xenakis et la musique stochastique (1963), le siècle de
Bruckner (1975), Musiciens de France (1979), Bela Bartok, trois forts
fascicules particulièrement pertinents
rédigés par Jean Gergely en 1980, Charles
Koechlin (1981), Claude Ballif (1984), Arnold Schœnberg et
l'Ecole de Vienne (1989), etc…
Dans le numéro 198 (février - mars 1946), Robert
Bernard
signait dans la Revue Musicale un article dont à
première
vue on pourrait s'étonner de le voir figurer dans cette
étude sur la réception française de la
musique de
Janáček. Sous le titre "Nationalisme et Internationalisme",
le
directeur de la revue à partir d'une statistique anglaise
portant sur la saison 44/45 essayait de tirer quelques
leçons.
Et pour nous, malgré l'aspect partiel de cette statistique,
nous
ne pourrons nous empêcher de comparer ces enseignements
à ceux que l'on peut tirer des programmes musicaux de nos
orchestres témoins de Lyon et de Paris. On se contentera de
mentionner les 18 compositeurs les plus fréquemment
joués
en Grande Bretagne. Sur ce premier graphique et si nous le rapprochons
de
ceux de Lyon et de Paris, nous percevons une constante, la place tenue
par Beethoven et Mozart et d'une certaine façon celle
occupée par les compositeurs de culture germanique
également présents dans les programmes
hexagonaux.
Remarquons le classement de Brahms chez nos amis britanniques alors que
sa musique ne parvenait pas encore à s'imposer chez nous.
Mais
signalons également la place de Tchaïkovsky presque
au
niveau des deux maîtres allemands entraînant dans
son
sillage ses compatriotes Borodine, Rimsky Korsakov et Rachmaninov et
provoquant chez le public anglais un culte de la musique russe dont la
ferveur paraissait bien plus profonde que celle du public
français. Par contre, la musique française
n'était pas
à l'honneur chez notre allié. Debussy ne
jouissait pas des
faveurs que l'on trouvait de ce côté-ci de la
Manche et
Berlioz à peine plus, ce qui pourrait nous
étonner quand
on sait l'intérêt qu'il suscite en Grande Bretagne
(que
l'on se souvienne que Colin Davis fut l'un des premiers à
enregistrer d'autres ouvrages du compositeurs de la Côte
Saint-André que sa
symphonie
fantastique).
Vérité en deçà de la
Manche… ! Les
Britanniques célébraient en beauté
leurs compositeurs (Elgar,
Delius) que nous ignorions alors totalement. Ils firent preuve de plus
d'intérêt pour des musiciens du Nord (Sibelius) et
continuaient de manifester leur attachement à
Dvořák dont ils
avaient si chaleureusement reçu la musique lors de ses
différents
voyages outre Manche.
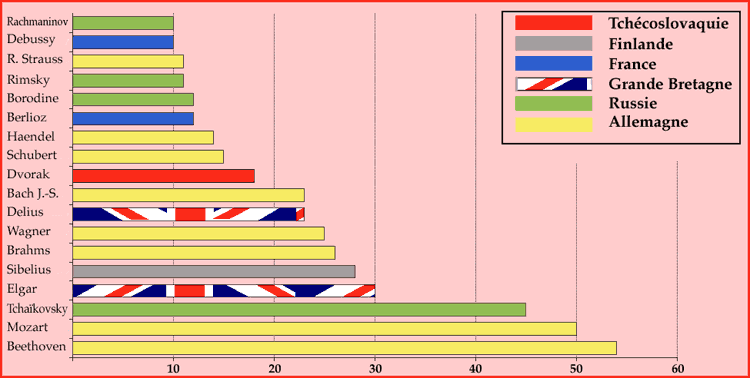 Les 18 compositeurs les
plus fréquemment joués en Grande Bretagne
Les 18 compositeurs les
plus fréquemment joués en Grande Bretagne
- 1944/45
(Nombre d'exécutions de leurs ouvrages)
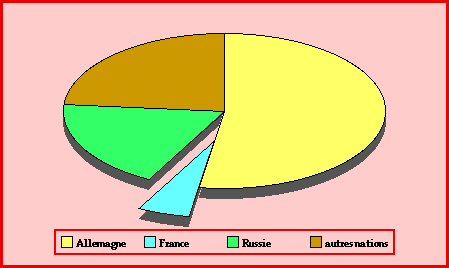 Grande Bretagne -
répartition par nations
Grande Bretagne -
répartition par nations (1944/45)
Au delà de ces
différences, la permanence de la musique allemande
à la
première place tant en Grande Bretagne qu'en France saute
aux
yeux. Par contre l'absence de tout compositeur vivant dans ce
palmarès (Richard
Strauss âgé de plus de 80 ans vivait ses toutes
dernières années et ne pouvait
représenter la
musique de l'avenir !) soulevait la place de la musique
contemporaine, au delà des
nationalités. Robert Bernard s'attacha à
énoncer
la problématique et à avancer des solutions.
"Il s'agit, en effet
d'honorer, de
propager, de défendre les œuvres des
maîtres qui,
à quelque pays qu'ils appartiennent, ont apporté
à
la civilisation un langage nouveau, une façon neuve de
penser
musicalement et de s'exprimer. Quoiqu'on pense et qu'on les aime ou
pas, depuis Wagner, ce sont en tout premier lieu Debussy,
Fauré,
Ravel, Roussel, Strawinsky, Prokofieff, Schoenberg, Hindemith,
Honegger, Alban Berg, Malipiero, Falla, Bartok, Milhaud et quelques
autres qui ont ouvert des voies nouvelles et doté la musique
d'œuvres fécondes en conséquences. Si
de tels
novateurs - indépendamment de la valeur
intrinsèque de
leur production et de l'attrait qu'elle exerce ou non sur nous - ne
sont pas familiers à l'esprit des mélomanes,
toute
l'évolution de la musique d'aujourd'hui qui en
découle
est inintelligible ou, du moins, l'optique de notre jugement en est
faussée et l'on se trouve enclin à attribuer
à
quelques pâles épigones les mérites qui
reviennent
à ces chefs de file. […]
Quand nous estimons que Strawinsky, Roussel, Falla ou Schoenberg
doivent être connus de tous les publics mélomanes,
ce
n'est en aucune façon pour ce qu'il peut y avoir de
spécifiquement russe, français, espagnol ou
autrichien
dans leur art, ce n'est même pas tant à cause de
la valeur
intrinsèque de leurs œuvres, mais parce qu'elles
sont
indispensables à l'intelligence de l'évolution du
langage
musical, parce que leur influence est universelle et que - qu'on le
veuille ou non, qu'on les aime ou non, qu'on s'en réclame ou
qu'on s'y oppose - nous ne pouvons faire abstraction de ce qu'ils ont
apporté à toute l'humanité musicienne."
Si l'on peut contester la présence de tel ou tel compositeur
dans la liste des chefs de file (Malipiero ?), telle que
l'établit Robert Bernard, nous ne pouvons que souscrire
à
la forte affirmation de la primauté de la
nouveauté dans
la technique et les moyens d'expression musicaux sur le
caractère national de tel ou tel. Quels que soient les
charmes,
les parfums, les couleurs et les rythmes particuliers
qu'amènent les attributs populaires qui singularisent la
musique
espagnole à travers Falla, la musique hongroise à
travers
Bartok et la musique tchèque à travers
Janáček, ce
qui distingue leur œuvre va bien plus loin que
l'héritage
que leur lèguent leurs maîtres anciens et qu'ils
cultivent
et embellissent. C'est bien un caractère universel qui fait
leur
valeur.
Au fil des pages de la Revue, nous apprenons l'exécution,
hors
hexagone, mais tout près de chez nous, par la
Société Philharmonique de Bruxelles au
cours de la saison 1946/7 de
Taras
Bulba alors qu'au programme des
concerts de l'UNESCO était annoncée pour le 30
octobre
1946 la venue de l'orchestre philharmonique tchèque
dirigé par Rafaël Kubelik avec la participation du
violoncelliste Pierre Fournier dans le
Concerto pour son
instrument de
Dvořák, l'ouverture de
la
Fiancée vendue de Smetana et la
Sinfonietta
de Janáček. Avec un tel programme dans lequel trois
compositeurs symbolisaient leur nation, on ne prenait aucun risque.
Toujours en 1946, dans le numéro 203 de
novembre-décembre, le compositeur
F. Bartoš
expliquait depuis Prague comment la capitale tchèque avait
pris
connaissance des quatre symphonies déjà
composées
par Martinů, dont la Première fut dirigée au
cours de
l'édition 1946 du fameux festival "Printemps de Prague" par
notre compatriote Charles Munch alors que la pianiste
française
Germaine Leroux jouera quelque temps plus tard la
Sinfonietta giocoso
(H 282) que le musicien lui avait dédiée en 1940.
Un peu plus tard, en
fin d'année 1947, la Revue annonça que la
participation
tchèque au futur festival de la SIMC du mois de juin
à
Amsterdam reposerait sur les épaules de Miloslav Kabelac et
sa
deuxième
symphonie.
Arrêtons-nous en 1952 à l'occasion de la
publication du
numéro 216 qui dressait un "tableau chronologique des
principales
œuvres musicales" de 1900 à 1950" suivant le titre
que
lui octroya son auteur. Le musicologue Henry-Louis de la Grange - qui
s'illustra
magnifiquement dans les années 80 par la publication de
trois épais volumes
consacrés à Gustav Mahler - établit ce
catalogue
divisé en trois grandes catégories :
opéras,
ballets, oratorios, cantates - musique symphonique - musique
instrumentale et mélodies. Observons les ouvrages retenus
de Janáček pour constater l'état de la
connaissance
française de sa musique, même s'il se
réduisait
à un état livresque.
| année |
œuvre |
année |
œuvre |
année |
œuvre |
| 1903 |
Jenufa |
1916 |
Journal
d'un disparu |
1924 |
L'Affaire
Makropoulos |
| 1904 |
Quatre
chansons moraves |
Chants
de Hradcany |
Le fou
errant |
| 1905 |
Kantor
Halfar |
1920 |
Ballade
de Blanik |
Jeunesse |
| 1907 |
Matrycka
Magdonova |
1921 |
Kata
Kabanova |
1925 |
Concertino
pour piano |
| 1908 |
Trio |
1922 |
Kaspar
Rucky |
1926 |
Sinfonietta |
| 1912 |
L'enfant
du musicien de village |
1923 |
Le
Rusé Renard |
1927 |
Maison
des Morts |
| 1914 |
Les
excursions de M. Broucek |
Quatuor |
Capriccio
pour piano main gauche et vents |
| Sonate
violon piano |
Les 70
000 |
Quatuor
II |
|
1928 |
Messe glagolitique |
Ce tableau appelle quelques commentaires. Tout d'abord, relevons
quelques erreurs de dates qui prouvent que, plus de vingt ans
après la disparition du compositeur, on n'avait pas en
France la
possibilité de disposer d'un catalogue fiable du ouvrages du
musicien morave, ce qui ne devrait pas nous étonner puisque
John
Tyrrell, Nigel Simeone et Alena Nemcova ne réussirent
à
en dresser un complet et vérifié qu'en 1997.
Rétablissons la chronologie. Le chœur les
70 000 ne
date pas de 1923, mais de 1909, de même Kaspar Rucky a
été composé six ans avant la date
indiquée sur le tableau, le Fou errant en
1922 et non en 1924, la Messe
glagolitique en 1926 et non en 1928. Quant à la Maison des morts,
au Quatuor II
et au Capriccio,
ils datent pour les deux premiers de la dernière
année
d'existence du compositeur, c'est-à-dire 1928, et pour
l'autre
ouvrage, de 1926. Ne jetons pas la pierre au rédacteur du
tableau pour ces erreurs somme toute bénignes. Nous sommes
plus
dubitatifs devant la présence d'une œuvre
fantôme,
le Trio de
1908. Si celui-ci
a bel et bien existé, puisqu'il a été
exécuté au cours d'un concert donné
à
l'Ecole d'orgue à Brno le 2 avril 1909, ce Trio
n'a pas été conservé. Pourquoi ? Sans
doute,
Janáček n'en était-il pas satisfait et l'a-t-il
détruit. Jaroslav Vogel, dans son beau volume, nous indique
que
des thèmes de ce Trio
ont été
réemployés dans le premier Quatuor
à cordes. N'ergotons pas non plus sur de mauvaises
transcriptions de certains titres, notamment celui de Maryčka Magdonova
qui porte le nom de la malheureuse héroïne du
poème
de Petr Bezruc et dont le prénom se retrouve
transformé
en Matrycka ! A cette époque, on continuait
à intituler le huitième opéra
de Janáček le
Rusé Renard
; il fallut encore un peu de temps pour qu'on s'aperçoive
que le
renard était en réalité une
renarde…! Enfin
l'Enfant du musicien de
village se voit plutôt traduit du titre
tchèque Sumarovo
dite par l'Enfant
du violoneux
et non pas par ce titre à rallonge. Si les opéras
sont
présents au nombre de six, par contre, comment expliquer
l'absence des ouvrages pianistiques du maître morave
? Aucune trace de la Sonate,
ni des deux cycles Sur
un Sentier recouvert et Dans les brumes…
Les interprétations au début des
années 50 en
furent certainement peu nombreuses et passèrent probablement
inaperçues, comme pour la Sonate
l'exécution par Jane Mortier en 1926 et 1927 et pour le
cycle Dans les brumes,
celle de Lyon en 1923 étaient passées
à la trappe de la mémoire collective.
Considérons maintenant le détail de ce catalogue
mis en
place par la Revue Musicale. Une part de stupéfaction saisit
le
lecteur devant la liste des opéras, ballets,
oratorios, cantates et chœurs
sélectionnés pour
l'année 1903. Si l'on y retrouve Jenůfa et Madame Butterfly, comment
accompagner ces ouvrages lyriques qui marquèrent l'histoire
de
l'opéra par d'autres productions certes honorables, mais pas
incontestables chefs d'œuvre comme Tiefland d'Eugen
d'Albert, Siberia
de Giordano, Cherubin
de Massenet et même Armide
de Dvořák, sans doute son opéra le moins
abouti, sans compter Dobrigo
Nikitch de Gretchaninoff, Ogaratuja du
Brésilien Alberto Nepomuceno ou encore la cantate Taillefer
de Richard Strauss. Même avec un recul de cinquante ans,
qu'il
est difficile de hiérarchiser la production de cette
année-là !
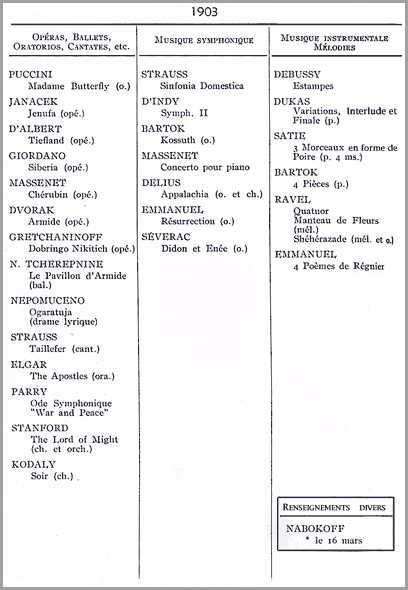 Principales
œuvres musicales en 1903
Principales
œuvres musicales en 1903 (la Revue Musicale
n° 216 - année 1952)
Toujours dans ce catalogue, Henry-Louis de La Grange listait les
compositeurs qu'il avait retenus. Au titre de la
Tchécoslovaquie
figuraient (en respectant la graphie employée) Anton Dvorak,
Alois Haba, Leos Janacek, Karl Boheslav Jirak
(avec une partie de son prénom germanisé, comme
pour
Dvorak), Ernest Krenek, Bohuslav Martinu, Vitezslav Novak, Felix
Petyrek, Josef Suk et Jaromir Weinberger, soit un total de 10
compositeurs. Prenons pour une coquille l'inclusion d'Ernest Krenek. Le
mérite de cette liste est de nous faire connaître
le nom du
Morave Felix Petyrek (1892-1951) dont, semble-t-il, il n'existe qu'un
enregistrement d'ouvrages pianistiques des années 1915
à
1928, exécutés par Kolja Lessing pour le compte
du label
Eda Records.
En 1957, la Revue destina un numéro double (239/40) au
IIIè congrès international de musique
sacrée. Dans
le chapitre qui traita de quelques compositions de
"l'ordinarium
Missae" modernes, le professeur Hellmuth Christian Wolff se pencha sur
deux ouvrages récents, la Messe
de Stravinsky datant de 1948 qu'il rangeait dans le "genre purement
liturgique, pouvant être employé pour la messe
elle-même" et la Messe
glagolitique
de Janáček qui répondait selon lui à
"un genre
inspiré par la foi, dans lequel on cherche une expression
subjective du texte de la messe", autrement dit une messe
non-liturgique. "Cette musique est si pure que, même sans la
connaissance de la langue, l'œuvre produit une forte
impression.
Cela est dû, semble-t-il, aux thèmes
utilisés
dont la mélodie, le rythme sont empreints de
majesté et
auxquels de systématiques répétitions
donnent tant
de relief.[…] La Messe glagolitique est l'acte de foi
subjectif
et religieux d'un esprit passionné." Pour clore cette
épaisse brochure, une discographie de musique
sacrée
relevait le Stabat Mater
de Dvořák et la Messe
slavone (glagolitique) de Janáček, deux
enregistrements dus à le firme tchèque Supraphon.
Passons maintenant au numéro 242 (1958) qui brossait un
panorama
de la musique dans le monde et intéressons-nous au chapitre
décrivant la situation musicale tchécoslovaque.
En neuf
pages, Vladimir Stepanek, délégué
permanent de la
Tchécoslovaquie auprès de l'Unesco, passait en
revue la
musique en Europe orientale : Russie, Pologne,
Tchécoslovaquie,
Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie et Roumanie. Pour le pays qui nous
intéresse, relevons quelques extraits de ses
écrits.
"C'est d'eux [J.-B. Foerster et Vítĕzslav
Novák] et également de Leos Janacek et Josef Suk
que se
réclame l'actuelle génération de
compositeurs." Et
de citer les noms d'Alois Hába,
de Václav
Dobiáš, Miloslav Kabelac,
Jan Hanuš, Isa Krejčí, Jan Kapr, Viktor Kalabis,
Petr
Eben, Jan Novák, Vladimir Sommer, Otmar Mácha et
Bohuslav
Martinů ainsi que des Slovaques Eugen Suchoň, Ján Cikker et
Ján Zimmer. La liste des compositeurs
tchécoslovaques
s'allongeait en s'enrichissant de noms nouveaux ! Mais sous
l'emprise du réalisme socialiste
qui régnait abondamment à cette époque
en URSS et
dans les pays satellites, l'article se terminait par deux citations de
Dimitri Chostakovitch qui se trouvait dans l'obligation de se soumettre
aux diktats artistiques décidés par la
bureaucratie
politique de son pays.
Cependant, fait absolument nouveau, la Revue Musicale inclut dans ses
pages deux publicités émanant de la firme
Supraphon qui
mit en avant deux compositeurs : Janáček et
Dvořák.
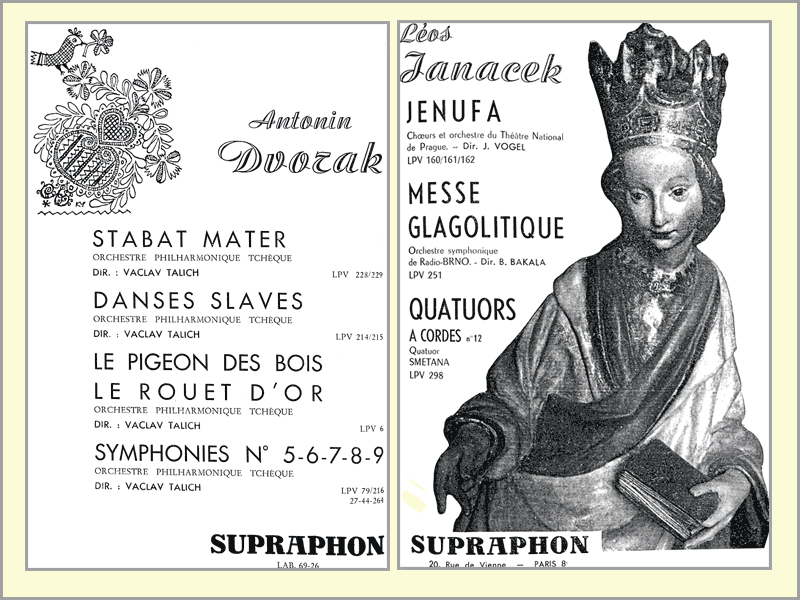 les premières
publicités
de la firme Supraphon dans la Revue Musicale
célèbrent Dvořák
et Janáček
les premières
publicités
de la firme Supraphon dans la Revue Musicale
célèbrent Dvořák
et Janáček
Au cours des Semaines musicales de Paris, le samedi 18 octobre 1958,
comme le relata la Revue, on entendit le Concerto da camera de
Martinů
datant de 1941 (H 285) et le jeudi 30 octobre, la Philharmonie
Tchèque qui avait fait le
voyage avec son chef Karel Ancerl présenta, sans
surprises,
deux joyaux de la musique de son pays (et que les Parisiens connaissait
bien !) : l'ouverture de la
Fiancée vendue de Smetana et la Symphonie du
Nouveau Monde de Dvořák
encadrant une Sérénade
d'Isa Krejčí - dont on peut penser qu'il s'agissait d'une
première audition française - et accompagna notre
compatriote le pianiste Samson François dans le fameux
troisième
concerto pour piano
de Prokofiev.
Franchissons à grandes enjambées les
années et les
numéros spéciaux qui
égrenèrent les
sujets à la fois les plus attendus et les plus hardis, de
l'hommage à Debussy pour le centenaire de sa naissance
à
celui à Jean-Philippe Rameau pour le bicentenaire de sa
disparition, de Claude Ballif
à Pierre Schaeffer (deux brochures en 1971 et 1977) en
passant
par les Journées de musique contemporaine à deux
reprises, de la musique africaine, de l'orgue français, de
la
vénerie et sa musique à Cosi Fan Tutte,
des trois magnifiques volumes dédiés à
Bela Bartok
par Jean Gergely, d'une brochure consacrée aux
sœurs
Boulanger, Lili et Nadia, des chemins en musique de Luciano Berio au
piano de Chopin et à celui de Szymanowski, d'une
contribution au
tricentenaire de Jean-Sébastien Bach, de Maurice Ohana
à
Joseph Kosma pour aboutir au numéro triple 388-89-90 en
1986.
Cette
brochure épaisse (un peu plus de 200 pages)
intitulée
"Musiciens d'Europe, figures du renouveau ethnoromantique",
mêle
sous la direction de Paul-Gilbert Langevin les figures de Franz
Schmidt, Franz Schrecker, Alexander von Zemlinsky, Max Reger, Ferruccio
Busoni, Leoš Janáček [et le
théâtre lyrique],
Hermann Goetz et Mieczyslaw Karlowicz, Carl Nielsen, Ralph
Vanghan-Williams, Ernest Bloch, Bohuslav Martinů et Heitor
Villa-Lobos. Intéressons-nous aux deux
représentants
tchèques.
Les pages 98 à 113 contiennent le texte d'une
causerie donnée par le directeur d'alors de l'Ecole Normale
de musique
de Paris, Jacques Feschotte le 3 juin 1959, suivies de notes, d'une
bibliographie et d'une liste des partitions des opéras. Quel
plaisir de découvrir au long de ces pages le fort
intérêt d'un musicologue pour le maître
morave qui
ne se contenta pas de lire le seul livre qui existait, celui de
Daniel Muller, mais qui fit le voyage de Brno et
pénétra au cœur de ses
opéras par l'audition
en langue originale de la plupart de ceux-ci. Si Jacques Feschotte
centre son intervention sur les opéras qu'il
décrit de
façon détaillée (notamment la Petite renarde
rusée et De
la Maison des morts), il n'en oublie pas les autres
facettes du compositeur : les deux quatuors, le Journal d'un disparu,
les deux cantates Amarus
et l'Evangile
éternel, la Messe glagolitique,
Taras Bulba,
la Sinfonietta.
"Cette opposition entre les âpretés dissonantes
qui
suggèrent le crime, la misère, les agonies, et la
touchante tendresse des pages consolantes, reste le propre de ce
cœur à la fois violent et passionné,
mais si
éminemment sensible à la souffrance"
écrit le
conférencier faisant allusion à De la Maison des morts.
Et un peu auparavant, il notait "L'étude approfondie de la
prosodie et des inflexions de la parole à laquelle
Janáček s'est livré pendant les vingt
premières
années de sa carrière […] le place
à
côté de Bartok dans la science musicale
contemporaine."
De la page 161 à la page 165, Harry Halbreich, dont nous
avons
relevé par ailleurs les fines analyses musicales
d'œuvres
de Janáček, mit son talent au service de Martinů
dont il
décrivit rapidement la carrière, s'attachant plus
précisément à l'œuvre
symphonique (les six
symphonies, les
Fresques de Piero della Francesca et les Paraboles) et
de son style qu'il définit ainsi "La notion de
thème
est-elle chez lui fort différente de ce qu'elle
représente chez les classiques : très souvent, ce
sont de
simples cellules, de courts fragments rythmiques ou
mélodiques,
qui se trouvent à l'origine d'un mouvement et qui se
développant petit à petit, porté par
le courant
musical comme par un fleuve, finissent par devenir d'amples et
admirables mélodies lyriques."
| compositeurs |
dates |
compositeurs |
dates |
compositeurs |
dates |
compositeurs |
dates |
compositeurs |
dates |
| Pavel Křížkovský |
1820-1885 |
Rudolf Karel |
1880-1945 |
Václav Kaprál |
1889-1947 |
Pavel Bořkovec |
1894-1992 |
Ján Cikker |
1911-1989 |
| Bedrich Smetana |
1824-1884 |
Otakar Šin |
1881-1943 |
Hans Krása |
1889-1944 |
Jaromir Weinberger |
1896-1967 |
Erwin Schulhoff |
1894-1942 |
| Antonín Dvořák |
1841-1904 |
Václav Štĕpán |
1881-1944 |
Vílem Petrželka |
1889-1967 |
Viktor Ullmann |
1898-1944 |
Jan Kapr |
1914-1988 |
| Zdeněk Fibich |
1850-1900 |
Jaroslav Křička |
1882-1969 |
Bohuslav Martinů |
1890-1959 |
Isa Krejčí |
1904-1968 |
Jan Hanuš |
1915-2004 |
| Leoš
Janáček |
1854-1928 |
Ladislav Vycpalek |
1882-1969 |
Karel Boleslav Jirák |
1891-1972 |
Theodor Schaefer |
1904-1969 |
Vítĕzslava
Kaprálová |
1915-1940 |
| Josef Bohuslav Foerster |
1859-1951 |
Jan Kunc |
1883-1976 |
Otakar Jeremiáš |
1892-1962 |
Jaroslav Ježek |
1906-1942 |
Jan Novák |
1921-1984 |
| Karel Kovařovic |
1862-1920 |
Jaroslav Novotny |
1886-1918 |
Felix Petyrek |
1892-1951 |
Jaroslav Kvapil |
1906-1958 |
Otmar Mácha |
1922 |
| Vítĕzslav Novák |
1870-1949 |
Emil Axman |
1887-1949 |
Oswald Chlubna |
1893-1971 |
Miloslav Kabelac |
1908-1979 |
Viktor Kalabis |
1923 |
| Josef Suk |
1874-1935 |
Boleslav Vomáčka |
1887-1965 |
Alois Hába |
1893-1973 |
Eugen Suchoň |
1908-1993 |
Petr Eben |
1929 |
| Otakar Ostrčil |
1879-1935 |
Julie Reisserova |
1888-1938 |
František Picha |
1893-1964 |
Václav Dobiáš |
1909-1978 |
|
Otakar Zich
|
1879-1934
|
Compositeurs
tchécoslovaques cités par la Revue Musicale
tout au long de son existence
|
Pas plus qu'une hirondelle ne fait le printemps, la Revue Musicale ne
modela le goût des mélomanes français.
Mais sa
lecture tout au long de ces vingt premières
années années d'existence mit en contact ses
lecteurs avec des courants musicaux novateurs, dont la musique
tchèque. En l'absence d'exécutions en grand
nombre, les
lecteurs se rabattaient sur le contenu de la Revue. Si la plupart des
concerts proposant cette musique se tenaient à Paris, les
mélomanes érudits de province pouvaient
néanmoins
tenter de se procurer une partition et appréhender plus
facilement ces nouveautés. Le nom de Janáček ne
pouvait
pas passer inaperçu. Mais cela ne touchait qu'un nombre
restreint de mélomanes, une élite. Et en
l'absence
d'exécutions plus nombreuses, sa musique ne pouvait percer.
Tout
au plus, jusqu'au début des années 1960, les
mélomanes se résignaient-ils à
inscrire son nom
dans un
coin de leur mémoire au cas où…
Si nous reprenons l'une ou l'autre des listes dressées par
les
divers commentateurs de la Revue et que nous nous interrogeons
maintenant sur l'étendue de la
pénétration de la
musique tchèque dans notre pays, force est de
constater notre méconnaissance complète
de la
musique d'un très grand nombre de ces compositeurs et
à plus
forte raison de ceux de la génération
tchèque actuelle.
Après guerre et compte tenu de la réorientation
de la
Revue, durant ces quarante années d'existence, on ne
découvrit que quelques mentions de la musique
tchèque et
de celle de Janáček ; un seul article, certes
consistant et
pertinent, en plus de trente ans ! Il fallut se tourner vers d'autres
publications pour trouver de nouvelles traces du compositeur morave,
malheureusement très rares, elles aussi. Les articles
suivants les évoquent.
Joseph Colomb - janvier 2006 (révision août 2006)
L'orthographe des citations a été scrupuleusement
respectée, si bien que la graphie des noms
tchèques se
trouve parfois éloignée de la graphie originale.