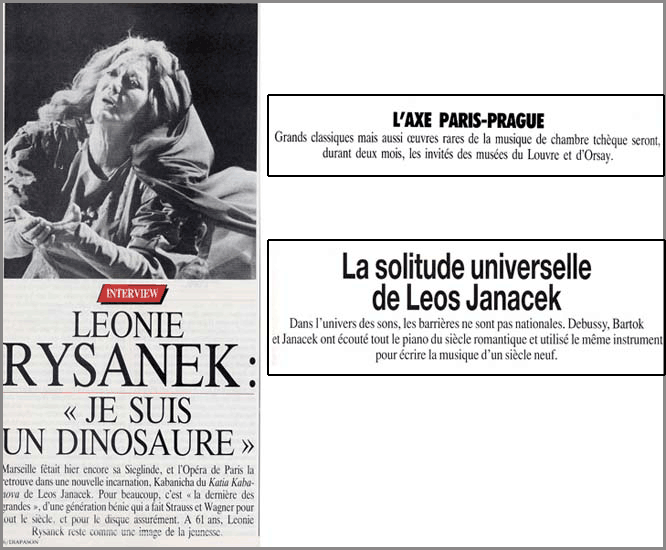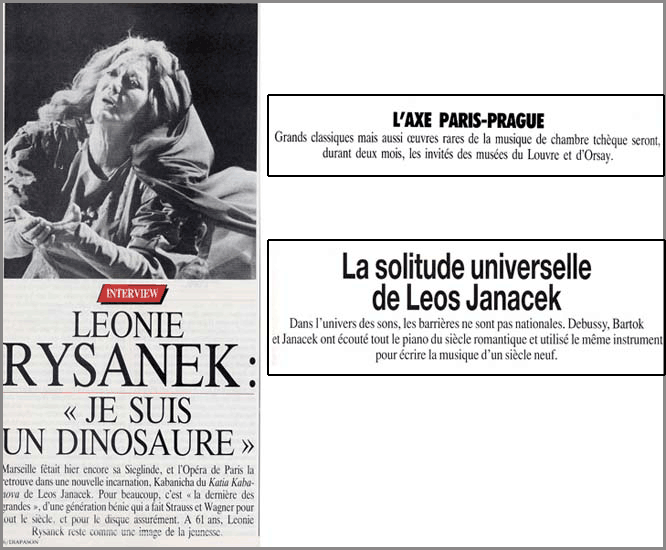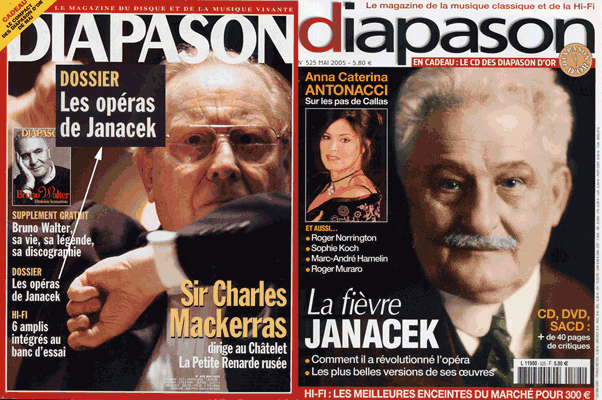La perception
française de la musique de Janáček
à travers les écrits (5)
La revue Diapason
La revue "Diapason" a été choisie, non parce
qu'elle est
plus pertinente ou plus documentée que "Le Monde de la
Musique" ou "Classica", autres revues présentes dans les
kiosques, mais simplement en raison de son
antériorité
sur les autres.
Elle permet de parcourir plus d'un demi-siècle
d'activité
musicale. L'année 1966 fixe le point de départ,
date
à laquelle la consultation des archives de cette revue a pu
être réalisée. Il s'agit d'examiner de
quelle
manière Janáček est perçu par
les critiques
qui rédigent cette revue, la fréquence
d'apparition des
articles, le degré de connaissance de ce compositeur. Pour
resituer cette recherche dans la période historique couvrant
ces
années, n'oublions pas la situation politique de la
Tchécoslovaquie, séparée de l'occident
par le
rideau de fer. Les échanges culturels ne se trouvaient
facilités ni par la différence de langue ni par
la
difficulté de s'y rendre. Les deux ou trois
années qui
précédèrent ce que l'on a coutume
d'appeler le
printemps de Prague (1968) marquées par un relatif
relâchement idéologique et
un bouillonnement intellectuel permirent une intensification de ces
échanges, mais la chappe de plomb retomba
lourdement sur le
pays dès 1969. Si des intellectuels, des artistes ou des
scientifiques réussirent à passer en occident,
triste
déchirement avec leur pays d'origine, ils
apportèrent
dans leurs bagages nombre d'informations, élément
positif
pour nous. Cette éclaircie dura peu de temps et de nouveau,
il
fallut glaner ça et là les actualités
musicales et
les avancées de la musicologie tchèque. Il n'est
donc pas
très
étonnant que la connaissance de la musique
tchèque de
notre siècle se soit faite si lentement.
Le concept d'une revue évolue forcément au cours
des
années et à plus forte raison au bout de
cinquante ans.
Il est banal de constater qu'un numéro
récent ne ressemble pas à un numéro
vieux d'une
vingtaine d'années et encore moins aux plus anciens
numéros. Tout
d'abord tourné vers la musique enregistrée, le
concept de
la revue Diapason s'enrichit avec la parution d'articles sur le
matériel auquel pendant longtemps on affubla le qualificatif
de
haute fidélité. Des articles de fond apparurent
analysant la
production symphonique ou opératique d'un compositeur (par
exemple, les
symphonies de Beethoven, les opéras de Wagner), des coups de
projecteur éclairèrent certains
interprètes, (pianistes, chanteurs,
cantatrices, etc…). La musique vivante trouva peu
à peu sa place avec des
notes de concert, des compte-rendus de représentation
d'opéras, des entretiens avec des musiciens tels que des
chefs
d'orchestre, des instrumentistes, des chanteurs. Des chroniques
parurent, faisant découvrir aux lecteurs des pans
cachés
de la vie et de l'œuvre de quelques compositeurs
célèbres, dévoilant l'existence
d'autres,
méconnus. Des écoles nationales y furent
décrites révélant des musiciens
ignorés
(école russe, nordique, ibérique, hongroise,
etc…).
Que pouvait-on apprendre sur Janáček ? Laissons de
côté les critiques de disques qui font l'objet
d'un autre
article. Examinons les papiers généralistes, les
notices
"musicologiques". A raison de onze revues mensuelles, de 1966
jusqu'à
2005, ce sont donc plus de 400 numéros qui ont
été
consultés, précisément du
numéro 103
jusqu'au 531 (1).
(1) Je n'ai
pas pu consulter
les numéros antérieurs à 1966, les
archives de la
bibliothèque municipale de Lyon ne les possédant
pas.
En 1966 et 1967, il fallait être un lecteur attentif pour
apercevoir le nom de Janáček au détour d'un
article.
Ainsi, en octobre, (numéro 110) dans une notice
dédiée au chef d'orchestre Rafaël
Kubelik, le
lecteur minutieux pouvait-il entrevoir un titre, celui de la Messe glagolitique,
de même en mai 1967, (numéro 117), dans le papier
intitulé "deux figures de notre temps, Kubelik, Penderecki"
la
mention de
Jenůfa
apparaissait. Il fallait, dans la revue
précédente éplucher le
palmarès des grands
prix du disque des dix dernières années
(Académie
Charles Cros, Académie du Disque Français, Grand
Prix des
Discophiles) pour trouver distingués les enregistrements du Petit renard rusé
et
des deux quatuors
à cordes, en 1959, de la sonate pour violon
et
piano, en 1960, de la
Messe glagolitique en 1964 et du Journal d'un
disparu
l'année suivante, toutes ces œuvres
interprétées par des musiciens
tchèques ! Le
mélomane devait se contenter de cette
énumération.
Notons quand même la sagacité et le
courage de la
plupart des jurys de ces grands prix qui n'hésitaient pas
à distinguer des œuvres encore peu
interprétées d'un compositeur que le "grand
public" ne
connaissait pratiquement pas. Il retrouvait la photo de la pochette du
disque de la Messe
glagolitique dirigée par Kubelik dans une
publicité de la
Deutche Grammophon. En 1968, rien. Dans l'éditorial du
numéro 137, juin 1969, il était
question d'un
"disque de Janáček qui comble une grave lacune de nos
catalogues", (une anthologie orchestrale regroupant les Danses de
Lachie, l'Enfant
du violoneux, la Ballade
de Blanik et l'ouverture
Jalousie,
encore un disque tchèque de la marque Supraphon !) Au
mois de mars 1970 - numéro 145 - le palmarès de
l'Académie Charles Cros distinguait dans la
catégorie piano au côté de Wilhelm
Kempff
interprétant des sonates de Schubert, les pièces
principales de Janáček jouées par Eva Bernathova,
tchèque, comme son nom le laisse deviner. Plus aucune trace
du
compositeur morave jusqu'au mois de mars 1972 où l'on
annonçait l'enregistrement de l'intégrale pour
piano sous
les doigts de Rudolf Kirkusny avec le concours de Rafaël
Kubelik,
sous le label DG, qui deux mois plus tard obtenait un Grand Prix des
Discophiles en catégorie musique instrumentale. Le
mélomane devait patienter jusqu'en septembre 1973 pour
trouver dans la
discographie de Karel Ancerl, mention de la Messe glagolitique,
de la
Sinfonietta
et de Taras Bulba.
En 1974,
un prochain enregistrement de la Messe
glagolitique sous la direction
du chef allemand Rudolf Kempe était annoncé,
tandis que
la revue dans son numéro 188 de juin/juillet se faisait
l'écho de la Tribune des critiques de disques, la
célèbre émission radio d'Armand
Panigel, qui passa
au crible le 5 mai, cinq versions différentes de cette Messe,
décidément un opus qui commençait
à obtenir
un début de célébrité.
Auparavant, au mois
de mars, dans la catégorie opéra de
l'Académie
Charles Cros, Le petit
renard rusé obtenait un grand prix qui ne
lui rendait cependant pas son véritable sexe ! Puis le
désert pendant deux années jusqu'au mois de
décembre 1976 (n° 212) où l'on apprenait
la
réimpression par les Editions d'aujourd'hui du volume de
Daniel
Muller, vieux de 46 ans (!), véritable aubaine pour tous
ceux
qui cherchaient à en savoir plus sur Janáček. Une
nouvelle traversée du désert dura trois ans.
Pendant cette
quinzaine d'années, aucun article, ne serait-ce d'une
dizaine de
lignes, ne traitait du compositeur morave. Pour apercevoir son nom ou
celui d'une de ses œuvres musicales, il était
indispensable de lire consciencieusement chaque page pour
dénicher occasionnellement sa présence. Celui qui
ne
connaissait pas ce compositeur en 1966 ne le connaissait pas mieux
quinze ans plus tard après avoir pourtant lu attentivement
chaque numéro de la
revue. Ne nous étonnons pas de ne voir cité aucun
de ses
opus dans la discothèque idéale en 25 disques,
dressée par les lecteurs de la revue en octobre 1966 qui
plaçaient Beethoven, Bach et Mozart en bonne position, mais
qui
pourtant désignaient le Sacre
du printemps de Stravinsky au
3è rang, Wozzek
d'Alban Berg en 18è, la Musique
pour
cordes, célesta et percussion de Bartok fermant
le rang. La
musique tchèque était
représentée en n° 9 par la Symphonie du Nouveau Monde
de Dvorak.
Un frémissement se fit sentir à partir de 1980,
frémissement léger, annonciateur de vaguelettes.
Pour les
vagues, il faudrait attendre. Si le nom de Gustav Mahler - pratiquement
inconnu vingt ans auparavant - envahissait
les colonnes de la revue au point de provoquer les indignations de
lecteurs, courroucés de cette "mahlermania", si
Béla
Bartok, Alban Berg ou Zemlinsky et Szymanowsky avaient eu droit
à des articles de
découverte pour ces derniers, d'approfondissement pour les
deux
autres, le nom de Janáček commençait à
apparaître, timidement au début des
années 80, un
peu plus franchement à la fin de la décennie.
Qu'on en
juge !
En 1980, dans cinq numéros de la revue, on retrouvait des
traces
de Janáček, d'abord dans la discographie de Rudolf Kempe,
ensuite dans un papier intitulé
"France-Tchécoslovaquie"
dans lequel L'Affaire
Makropoulos se trouvait mentionnée, tandis que
l'opéra Jenůfa
était évoqué à propos de la
programmation prochaine de l'Opéra de Paris alors que
l'éditorial du n° 256 de décembre citait
le nom
de Janáček et que la maison Decca affichait la
pochette du
coffret de l'opéra De
la maison des morts.
Mais le mois
précédent, les mélomanes avaient eu la
surprise de
trouver sur une pleine page - un événement ! -
une
publicité Supraphon présentant les
enregistrements de
Janáček disponibles sur le territoire
français.
L'année suivante, dans la revue de janvier 1981 (n°
257), un
compte-rendu décrivait Jenůfa
qui venait de voir le jour
à l'opéra de Paris avec la soprano Rachel Yakar
dans le
rôle titre et Nadine Denize dans celui de Kostelnicka. Dans
le
même numéro, on pouvait prendre connaissance de la
parution du livre de Guy Erismann "Janáček ou la passion de
la
vérité", premier ouvrage distribué par
un
éditeur d'envergure nationale. Nul doute qu'il contribua
à une première
appréhension du compositeur morave.
Par contre, aucun opéra de Janáček ne
s'insèra
dans la liste des "25 opéras dans votre
discothèque"
dressée par le critique André Tubeuf (dont
Orphée
de Gluck, Faust,
les Noces de Figaro,
Don Juan, la
Flûte enchantée, Tosca, Eugène
Onéguine,
Aïda,
Falstaff, Salomé, Pelléas et
Mélisande
et parmi les "modernes", Wozzek
et Peter Grimes).
Huit ans après
la Messe glagolitique,
c'était au tour de la Maison
des morts
de passer
devant le jury de la Tribune des critiques de disques dont la revue
Diapason (n° 277, novembre 1982) offrait un
résumé
succint
donnant aux lecteurs la possibilité d'approcher un
opéra
pratiquement encore inconnu en France. L'opéra de Nice
l'avait
bien créé en 1966, mais pendant les
seize années suivantes, il ne s'était rien
passé
et on attendait qu'une autre salle reprenne l'initiative ce qui ne se
réalisera qu'en 1988 à Paris et à
Nancy.
En 1983, la représentation de deux opéras de
Janáček (Petite
renarde rusée à Strasbourg, Katia
Kabanova à Bruxelles grâce
à
l'opiniâtreté de Gérard Mortier)
donnèrent l'occasion
de compte-rendus dans la revue. Bribes par bribes, morceau par morceau,
le voile
d'ignorance qui entourait Janáček en France se
lèvait
lentement. Le "Voyage à l'intérieur de la
Philharmonie
tchèque" en deux pages, au mois de juin, engendra de
nouvelles mentions du compositeur, de même qu'une
évocation du Printemps musical de Prague. Ce festival de
musique
de plusieurs semaines de concert, ramèna en 1984 le nom de
Janáček dans les pages de la revue en juillet-août
alors
que le Théâtre national de Chaillot programmait
peu
avant les Carnets d'un
disparu, occasion de lever un nouveau coin du
voile.
Une vaguelette un peu plus prononcée achemina sur nos
rivages
des compliments puisque Harry Halbreich, en connaisseur, compara
Janáček à Alban Berg pour ses hautes
qualités
musicales. La Monnaie de Bruxelles jouant Katia Kabanova
à Paris
et Charles Mackerras y dirigeant un concert avec
Janáček
aux côtés de Mendelssohn, Beethoven, Dvorak - on
pourrait
être plus mal entouré ! - symbolisèrent
deux balises qui
signalaient l'existence du compositeur morave. En fin
d'année,
nouveau signe que les choses bougeaient imperceptiblement, mais de
manière significative, la création du Mouvement
Janacek
présidé par Guy Erismann.
Abandonnons un instant le cadre de Diapason pour nous
intéresser
à un groupe socioculturel plus nombreux bien que difficile
à cerner, celui des mélomanes français
(qui ne
lisent pas tous une revue musicale). L'institut IPSOS questionna cette
population : " dans cette liste d'opéras, lequel
préférez-vous, et ensuite ?" Voici le
résultat,
tel que le transmit la revue dans son numéro 303 de
mars 1985, numéro qui marquait l'union de la revue Harmonie
avec
sa consœur Diapason.
| opéra |
pourcentage
obtenu |
| Don Giovanni |
53 |
| Carmen |
36 |
| Traviata |
28 |
| Faust |
15 |
| Les Maîtres chanteurs de Nuremberg |
15 |
| Orféo |
13 |
| Pelléas et Mélisande |
11 |
| le Chevalier à la rose |
9 |
| Wozzeck |
3 |
Les critiques influencent-ils les mélomanes ou suivent-ils
les
goûts dominants ? Vaste question qu'on laissera sans
réponse. On ne peut que rapprocher ce classement avec celui
que
trois ans plus tôt, André Tubeuf
établissait
dans son palmarès personnel des 25 enregistrements
d'opéras et évidemment y constater l'absence de
tout opéra de Janáček.
Coup sur coup, dans le numéro 307 de juillet-août
1986,
trois mentions du maître de Brno furent parsemées
dans des
articles différents. L' éditorial examina de
prodigieuses
décennies et, dans celle de 1905 - 1914, cita
Janáček. L'Opéra de Lyon monta les Excursions de M.
Broucek et Rudolf Firkusny, invité du festival
de piano de La
Roque d'Anthéron honora son ancien maître par une
de ses
compositions.
En 1987, les compte-rendus de représentation
d'opéras se
succèdèrent avec Jenůfa à
Marseille réhaussée
par la présence de Leonie Rysanek, des Excursions de M. Broucek
à Lyon et de Jenůfa
une seconde fois, hors hexagone, au
théâtre de la Monnaie à Bruxelles
où
Gérard Mortier poursuivait son travail de
dépoussierrage du
répertoire. A l'occasion d'un reportage sur notre
compatriote,
le pianiste Alain Planès, il fut question du cycle Dans les
brumes. Enfin la discographie de Claudio Abbado permit de
retrouver la
Sinfonietta
voisinant des œuvres prestigieuses des
géants de la musique comme Beethoven.
Mars marque le terme de l'hiver. La fin de l'hiver français
de
Janáček s'approcherait-elle ? A Paris, pas moins de quatre
concerts placés sous le signe de Janáček se
déroulèrent du 11 au 31 mars. La plupart des
pièces pour
piano solo y furent programmées, accompagnées des
deux
œuvres concertantes, le Capriccio
et le Concertino
ainsi que le
premier quatuor à cordes, le sextuor pour instruments
à
vents Mladi
(Jeunesse) et le Journal
d'un disparu que les
Montpélliérains purent aussi entendre trois jours
de
suite au début de ce mois. Ajoutez à ce programme
alléchant deux
opéras, Kata
Kabanova et De
la Maison des morts. Bien
évidemment, le mois suivant, un compte-rendu de ces concerts
fut
rédigé. Nouvelle occasion de voir le nom de
Janáček s'inscrire sur les pages de la revue. Un label
français Calliope offrit le cycle pianistique Sur un sentier
broussailleux - qui n'avait pas trouvé son
adjectif
adopté maintenant "recouvert" - sous les doigts de Radoslav
Kvapil, pianiste tchèque. Comme un peu plus
tard, le quatuor Talich fut à l'honneur et que ses quatuors
à cordes appartenaient à leur
répertoire et
à leur discographie, le nom de Janáček s'imprima
de
nouveau dans les colonnes de la revue et peut-être
commença
à se graver dans les
mémoires des lecteurs. Enfin la saison estivale des
festivals
ramèna l'Affaire
Makropoulos à l'affiche. Et l'on
annonça
la prise de rôle prochaine de Leonie Rysanek dans Kata Kabanova.
De la Maison des morts se déplaça de
Nancy à Tours et
à Lyon début 1989. La revue attira l'attention
sur les
100 livres sur la musique et parmi eux recommanda le seul titre
disponible en français bien que déjà
ancien de
neuf ans, celui de Guy Erismann. C'est encore grâce
à un
pianiste tchèque de nouveau invité en France, et
quel pianiste,
Rudolf Firkusny qu'il fut question du cycle Sur un sentier recouvert
du
musicien morave. Les éditeurs de disques étant
mis sur la
sellette en octobre, la maison Vogue, alors distributrice
française des enregistrements Supraphon annonça
l'arrivée
d'une série économique, la collection Crystal
où
se situèrentt en bonne place les enregistrements anciens de
Karel
Ancerl dont la valeur musicale résistait
à l'usure
du
temps. Du bonheur pour les mélomanes au portefeuille modeste
!
La libéralisation du régime politique en
Tchécoslovaquie après la révolution de
velours fit
l'effet d'un grand bol d'air frais et vivifiant. De nouveau, les
nouvelles pouvaient circuler. On ne se contentait plus de placer au
premier rang les compositeurs officiels ou
désignés comme
tels, du passé ou du présent. Des musicologues
tchèques, muselés jusqu'ici, qui avaient
dû se contenter
de ruser, proclamaient à voix plus hardie leurs certitudes.
Un
réexamen de la situation pouvait avoir lieu. Ce regard
"neuf" ne
touchait pas seulement les Tchèques, mais, comme une vague
tranquille, commençait à imprégner les
musiciens
occidentaux, les critiques, les metteurs en scène, les
décideurs artistiques de tous ordres, directeurs musicaux
d'orchestres et d'opéras. Les anciennes
réticences dues
à l'ignorance fondaient doucement et un courant de
sympathie,
encore timide, envisageait plus sereinement les écoles
"exotiques"
de cette Europe Centrale dont jusqu'à présent on
n'avait
voulu voir et entendre que Bartok en Hongrie, une petite part de Dvorak
en Tchécoslovaquie et la Moldau
emblématique de Smetana.
Le temps d'autres courants, différents, plus novateurs ou
plus
modernes, dans lequel s'incluait Janáček, pouvait venir.
Katia Kabanova passa la rampe à
l'Opéra-Bastille, dans un
environnement de trois concerts. Une manière
remarquée
pour distinguer l'originalité du musicien morave.
Compositeur
d'opéras, certes, et d'opéras qui
commençaient à
trouver leur audience dans le public français, mais aussi
auteur
de quatuors, de pièces pour piano et également
d'écrits, des feuilletons que l'on s'évertuait de
glisser au
milieu de pièces musicales. De la Maison des morts,
production
lyrique de la Monnaie de Bruxelles
s'étala sur un quart de page en juillet 1990. Proportion
encore
modeste. Impossible cependant de rater ce compte-rendu. Il faut
toutefois continuer à chercher la présence du
compositeur
dans les recoins, mais de temps en temps cette présence dont
la
fréquence s'accroissait se signalait à notre
attention
par un titre en gras, par un encadré, par une surface
inaccoutumée. En fin d'année, un grand article
raconta
l'axe Paris-Prague dans lequel le Morave Janáček ne
tenait
forcément qu'une place modeste. Mais comme
le rédacteur s'appelait Pierre-Emile Barbier (qui
bientôt
lancera les disques Praga), il savait de quoi il parlait et il en
parlait
bien.
C'est à propos d'un pianiste, Andras Schiff, promu une des
têtes d'affiches de la revue que le Journal d'un disparu
revint
trois ans après ces fameux concerts parisiens. Les
perspectives
salzbourgeoises du festival inscrivirent De la Maison des morts
dans un
futur proche. L'année suivante la marseillaise Kata
portée par Leonie Rysanek provoqua un rappel de
mémoire
au lecteur et s'il plongeait, dans le même numéro,
dans la
discographie de Neeme Jarvi, chef esthonien, il y retrouvait la
Sinfonietta.
Un peu plus tard, le quatuor Hagen, autrichien,
s'empara des deux quatuors de Janáček alors que d'Autriche
toujours, arrivait le succès de la Maison des morts.
Dans la
longue et passionnante interview de Simon Rattle, on croisa le
maître morave, rencontré à quatre
reprises par le chef anglais
se traduisant dans sa discographie par autant d'enregistrements.
En 1993, ce fut au tour du quatuor Alban Berg de se saisir des deux
quatuors de Janáček, alors que Kata Kabanova
réapparut dans la saison d'opéra à
Paris.
Pierre-Emile Barbier nous gratifia d'un nouvel article sur la musique
tchèque où se glissa le nom du compositeur morave
tout au
long des lignes de "La Bohême du silence". Enfin
l'année
suivante, dans l'hommage à la grande soprano d'origine
slovaque,
Lucia Popp qui venait de disparaître, Jenůfa et la Petite renarde rusée
qu'elle incarnait si délicieusement pour l'une, si
humainement
pour l'autre, elle la si fine mozartienne, resteront dans nos souvenirs
grâce à ses enregistrements. Une
autre disparition, celle du pianiste Rudolf Firkusny permit aux
mélomanes de s'incliner devant sa mémoire et
celle de son
maître, Janáček, qu'il avait si souvent
joué.
D'Angleterre, de Covent Garden et de Glyndebourne
précisément, nous parvinrent les échos
d'opéras de Janáček. Comme pour leur tendre un
miroir,
Strasbourg, la courageuse, livra dans un encadré d'un
huitième de page des nouvelles des
représentations de
l'Affaire Makropoulos évoquant
au passage M. Broucek
et ses
aventures et l'ultime De
la Maison des morts.
Accordons-nous une pause et jetons un regard en arrière.
Depuis
1966, le lecteur intéressé par la musique
tchèque
en général et Janáček en particulier
s'est
promené dans les pages de la revue, comme pendant des jours
hivernaux où le brouillard recouvre tout, où les
traces
s'effacent sous la neige qui tombe, où la connaissance de ce
compositeur dont on entrevoit parfois un pan se laisse difficilement
percer. Dans nos habitudes musicales françaises bien
ancrées, du mélomane à
l'interprète et au
musicologue ou journaliste spécialisé, la
perception que
nous avions de la musique tchèque ressemblait à
celle
d'une
île lointaine et quasi déserte, d'où
émergeaient
une Moldau
et une Fiancée
vendue de Smetana, une Symphonie du
Nouveau Monde, un concerto pour violoncelle, des danses slaves,
quelques quatuors de Dvorak et une poussière
d'œuvres de
Janáček. Encore fallait-il, pour ce dernier, que des
interprètes tchèques se dévouent. La
Philharmonie
tchèque arrivait bien à faire quelques
tournées en
occident entraînant dans son sillage quelques rares
interprètes tchèques et amenant dans ses bagages
telle ou
telle page orchestrale du maître de Brno,
l'interprétation
de sa musique dans nos contrées reposait surtout sur les
épaules de musiciens
expatriés, tel Rafaël Kubelik, Rudolf Firkusny et
le chef
australien Charles Mackerras qui s'était
découvert une
deuxième patrie dans la musique tchèque et celle
de
Janáček nous permettant la connaissance parcellaire de
celle-ci.
Cette situation dura une bonne vingtaine d'années. Il fallut
la
perspicacité de Michel Hoffmann, rédacteur en
chef de la
revue pendant une courte période, la grande connaisance du
fait
culturel tchèque par Pierre-Emile Barbier, un
intérêt croissant d'un ou deux autres journalistes
comme Olivier Opdedeeck pour
que, comme avec les cailloux du Petit Poucet, le lecteur parvienne
à
suivre à
intervalles irréguliers un cheminement sans
signalétique
évidente. Au fur et à mesure que des
interpètes
occidentaux d'envergure, chefs et solistes, s'appropriaient une partie
de cette œuvre, des questions se posaient. Si
Léonard
Bernstein, Claudio Abbado et Simon Rattle, par exemple,
s'intéressaient à des pièces
orchestrales du
compositeur morave, les critiques ou musicologues encore peu au fait de
l'œuvre de Janáček ne devaient-ils pas jeter un
œil
(et une oreille) plus attentifs sur ce compositeur pour ne pas rater le
train lorsque celui-ci s'ébranlerait. Il est de fait
qu'après avoir longtemps boudé son
œuvre
opératique, des directeurs d'opéras
français
montrèrent progressivement un intérêt
croissant
pour ces pièces. Ce mouvement s'amplifia doucement,
relaté par la presse musicale qui s'en fit les
échos dans
les colonnes de Diapason (comme dans celles d'autres revues)
jusqu'à cette année 1995 que je vous propose
d'examiner
maintenant.
1995, l'année du déclic. Non que les articles
aient
fleuri chaque mois, scandant un passage obligé pour les
amoureux
de la musique du maître morave, et les autres, mais trois
pavés lancés au cours de l'hiver, au printemps et
en fin
d'année émirent le signal. Tout
commença au numéro 412 par la chronique
d'André Tubeuf, toujours aussi incisif pour
dévoiler la vérité profonde
plutôt que
l'habillage ou le masque. Et l'hommage s'adressait à un
pianiste
français qui jouait Janáček aussi bien que les
compatriotes du compositeur. De cette chronique intitulée
"La solitude
universelle de Leos Janacek", on comprit bien qu'il ne suffisait pas
d'être tchèque ou natif de Brno pour bien jouer
Janáček, mais qu'il fallait avant tout chose comprendre la
solitude
du compositeur. Alain Planès l'avait rencontrée,
cette
solitude et nous l'offrit sur un disque Harmonia Mundi, toujours
distribué en 2006. Au mois de mai, (n° 415) Charles
Mackerras, un chef d'orchestre australien que rien, au
départ,
ne prédisposait à entrer en résonance
avec le
compositeur morave, était interrogé sur trois
pages. Plus de la
moitié de ses propos relatait la passion qui l'habitait et
la
mission qu'il s'était fixée,
révéler au public
européen de l'ouest la musique orchestrale et les
opéras
de Janáček. Interview imposée par la
création française de
la Petite renarde
rusée à l'opéra de Paris.
Suivirent cinq pages titrée "un moraliste à
l'opéra"
sous la plume que les circonstances d'alors présentaient,
sinon
comme le spécialiste, du moins comme celui qui, à
ce
moment-là et à cet endroit, le
connaissait le
mieux, Guy Erismann. Tout au long de ces pages, se déroulait
le
fil qui partait de Šarka,
premier opéra de Janáček pour aboutir
à
De la Maison des morts,
ultime opéra, reliant l'ensemble des
autres opéras. La livraison 417 de la revue revint sur trois
quarts de pages sur la représentation parisienne de cette Petite
renarde. Pour clore le tout, en décembre, la
production nancéenne de Jenůfa dans
laquelle la soprano Eva
Jenis tenait le rôle titre (après avoir
habité la
forêt parisienne en prétant sa voix à
la renarde) parachèva
l'année dont chaque mélomane ne put sortir en
confessant
encore son ignorance vis-à-vis de Janáček et de
sa
musique.
Extraits de la revue Diapason
L'année 1996 apporta son lot de mentions d'opéras
et
d'autres œuvres de Janáček qu'il fallut
recommencer
à aller pêcher dans tel ou telle chronique, y
compris
là où on ne s'y attendait pas. En avril, la revue
fêta son quarantième anniversaire. Pour marquer
dignement
ces 40 années au service du disque et de la musique un
palmarès des 40 enregistrements d'opéras
marquants est dressé. Et
cette fois-ci, Janáček y est
représenté par le
coffret Kát'a
Kabanová dirigé par Charles
Mackerras. Un tournant
a été pris ! Au hasard des notices sur tel ou tel
artiste, le chef tchèque Karel Ancerl, la jeune soprano
française Mireille Delunsch, le quatuor tchèque
Pražak,
le chef britannique Simon Rattle, le pianiste finlandais Ralf Gothoni,
ou encore d'un hommage à Rafaël Kubelik,
surgissent les titres
d'un opéra ou d'une œuvre de musique de chambre du
compositeur morave. Rouen accompagna les pièces de piano qui
commençaient à être reconnues en France
grâce
à l'enregistrement récent d'Alain
Planès
rejoignant ceux plus anciens de pianistes tchèques, par un
quatuor à cordes et Rikadla,
ces extraordinaires comptines. En
1997, le calme plat. Mais en 1998, les mentions de Janáček
réapparaissent. Dans le cadre notamment, d'une animation
conduite par
l'Auditorium du Louvre associant concerts, expositions et films qui
montrèrent la Petite
renarde rusée
et le long-métrage de Jaromil
Jirès tourné en 1986 "le lion à la
crinière
blanche", cette expression désignant Janáček et
sa
chevelure blanche devenue célèbre à
Brno dans les
dernières années de sa vie.
Certains opéras et les deux quatuors continuèrent
à
être cités au hasard d'articles concernant le
festival
d'Aix en Provence et celui de Salzbourg. Le numéro 473 de
septembre 2000 proposa 50 disques pour découvrir le piano.
Les
responsables de ce choix de disques ne crurent pas devoir retenir
l'enregistrement d'Alain Planès, par exemple, aux
côtés d'œuvres
célébrissimes de
Beethoven et Chopin. Dans la musique du début du
XXè
siècle, Janáček n'était pas encore
digne de marquer sa
place ! L'année 2001 n'apporta pas de contribution
marquante.
2002 ayant été désignée
comme
l'année tchèque, les festivités
s'organisèrent sous
le sigle Bohémica Magica. Ce fut l'occasion dans le
numéro
493 du mois de juin d'étaler sur neuf pages sous le titre en
forme de clin d'œil "La symphonie de l'ancien monde", la
musique
à Prague et ses composantes. La revue suggèra
vingt
disques pour découvrir la musique tchèque.
Devinez,
lecteur, la proportion réservée à
chacun des
compositeurs… L'accroche de ces deux pages se
présentait
ainsi :"Impossible d'échapper à la volumineuse
discographie de la trinité Smetana-Dvorak-Janacek. Mais du
baroque aux heures sombres du XXe siècle, Bohême
et
Moravie réservent des trésors aux oreilles
aventureuses…" Belle entrée en matière
qui laissait
augurer une suite savoureuse. D'autant plus
que Janáček
occupait la part du lion (avec ou sans sa crinière blanche)
avec
six enregistrements,
Jenůfa,
l'incontournable Jenůfa,
mais aussi La Petite
renarde
rusée, l'Affaire
Makropoulos, les deux quatuors, la Messe
glagolitique, et un disque d'œuvres orchestrales
regroupant avec
la non moins incontournable Sinfonietta,
Taras Bulba
et le Concerto
pour violon récemment "découvert".
Jenůfa fut encore à l'honneur en 2003 avec la
conversion d'un
chef historique que l'on connaissait familier des terres mahleriennes,
brahmsiennes et wagnériennes, Bernard Haitink qui comptant
sur la
complicité de la grande Anja Silja et de la soprano
finlandaise
Karita Mattila conduisit cet opéra à Londres et
dans la
foulée l'enregistra. Autre conversion, celle de Pierre
Boulez
dirigeant - semble-t-il - pour la première fois en Europe
des pièces orchestrales
du maître de Brno. On ne pouvait plus dire que la musique de
Janáček parce que trop tchèque ou trop
morave, c'est
selon, était réservée à ses
compatriotes !
On aurait pu penser que 2004 allait offrir la consécration
à Janáček pour le cent
cinquantième
anniversaire de sa naissance et le centième anniversaire de
la
création de Jenůfa.
Il n'en fut rien. Mais ce n'était que
partie remise. L'année suivante, impossible de rater ses
quatre
opéras majeurs. Kata
Kabanova et De
la Maison des morts occupaient
la scène de l'Opéra Bastille à Paris
aux deux
extrémités de la saison et l'opéra de
Lyon,
suprême audace, programmait en alternance sur un mois de mai
débordant sur juin trois opéras incontournables, Jenůfa,
Kata Kabanova
et l'Affaire Makropoulos.
Sentant la brise se lever, en
bon capitaine, la revue Diapason réserva sa couverture (une
première) et douze pages intérieures à
la
"fièvre Janáček" allant jusqu'à se
déclarer
"janacekolâtre" ! A déguster, les notes
pétillantes
et pertinentes de Jean-François Zygel, fin musicien, qui
saisit
l'essence de la musique du maître morave avec autant
d'économie que l'auteur de
Jenůfa en
usait dans ses compositions ! La revue Classica, en février,
avait pris
les devants. Sur la couverture le vieux lion à la
crinière blanche nous jetait un regard
énigmatique.
Jérémie Rousseau déroula sur dix pages
une
enquête de vérité sur le compositeur
morave,
scrutant avec sagacité les coins et les recoins de
l'âme
complexe du compositeur. Seul dans ce concert de revues musicales, le
Monde de la Musique, resta muet.
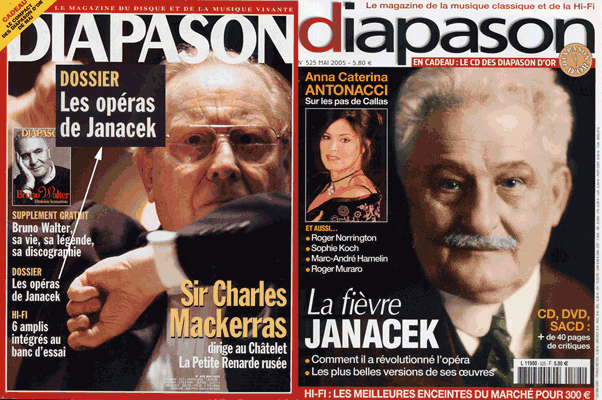 A dix ans d'intervalle,
deux couvertures de la revue Diapason (1995 - 2005) - montage
photographique
A dix ans d'intervalle,
deux couvertures de la revue Diapason (1995 - 2005) - montage
photographique
Joseph Colomb - janvier 2006 (révision juin
2006)
Je
remercie infiniment Mme Breuil, responsable de la section
discothèque de la médiathèque Aragon
de Rive de
Gier pour son aide - ainsi que ses collaborateurs - dans la mise
à ma disposition des archives de
la revue Diapason de ces quinze dernières années.