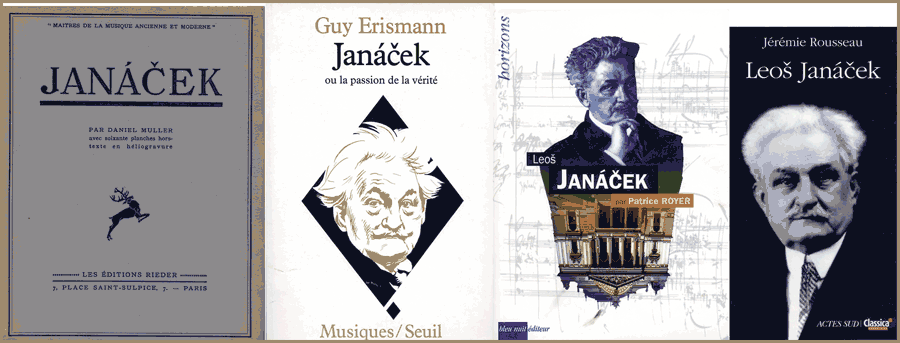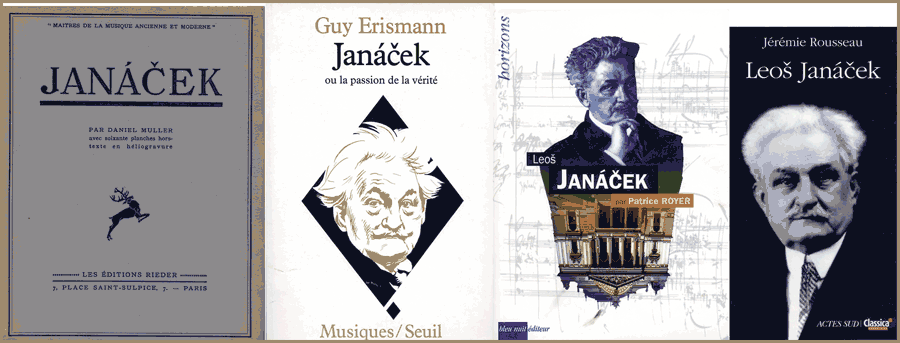La perception
française de la musique de Janáček
à travers les écrits (4)
Les livres spécialisés
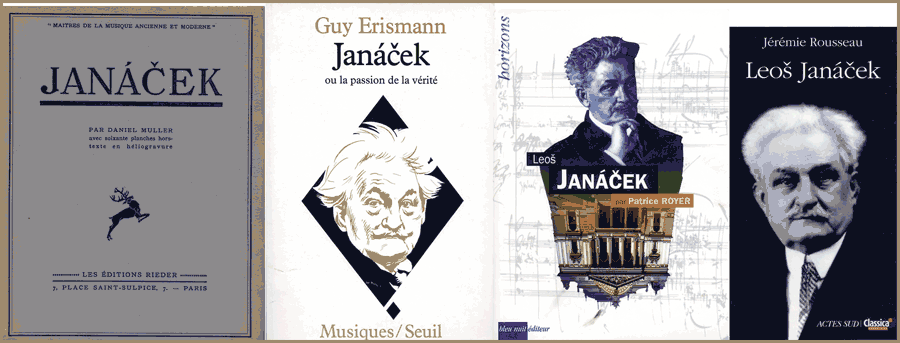 de 1930 à
2005, Janáček
n'a été illustré que quatre fois par l'édition musicale
française
de 1930 à
2005, Janáček
n'a été illustré que quatre fois par l'édition musicale
française
Seuls, deux livres s'attachent
à la musique tchèque
Dans un champ plus large couvrant l'ensemble des pays
tchèques,
nous ne trouvons que deux livres. En 1982, les Presses Universitaires
de France dans leur populaire collection "Que sais-je"
éditèrent une petite
brochure centrée sur l' Histoire de la musique
tchèque,
due à la plume de Jean-Claude Berton. Pour la
première
fois, on s'intéresse à l'histoire musicale de ce
pays.
L'auteur, après avoir montré que la musique
tchèque existait bien avant le XIXè
siècle en listant
un grand nombre de compositeurs tchèques de la Renaissance
à l'âge baroque, octroie une place confortable
à
Smetana avec 8 pages, démontre la valeur de
Dvořák sur plus de 6
pages et de Janáček qu'il gratifie de 4 pages. "C'est
dans les rythmes et les tons du folklore morave qu'il a
puisé sa
matière musicale. Plus attentif à l'impulsion
dramatique
de sa force créatrice et à sa puissance
émotionnelle instinctive qu'à la soumission
à un
style, il donne parfois l'impression d'un anti-conformisme
déroutant dans ses variations et dans son laconisme, mais
l'originalité et la conviction qu'il a mises au service
d'une
œuvre de lente maturation ont fait de ce Morave un
compositeur
universel" écrit-il en page 110 de son livre. Enfin
en 2001, Fayard mit à la disposition des
mélomanes un
fort ouvrage de 600 pages, rédigé par Guy
Erismann, une
Histoire
de la musique dans les pays tchèques qui en
décline la
chronologie en quatre parties : des temps anciens à la
Montagne
Blanche, des ténèbres aux lumières, la
musique et
la question nationale, la musique en liberté. C'est donc
à un panorama d'ensemble de l'histoire musicale
tchèque
qu'il nous convie. "Il existe peu d'exemples d'artistes capables
d'explorer la tradition avec tant d'attention et d'en extraire la
dynamique cachée pour créer une dynamique
nouvelle, celle
de la vérité, s'appuyant non sur des tics du
passé, mais sur les sources secrètes du langage,
traduction authentique des pulsions vécues." peut-on lire en
page 394 à propos de Janáček.
Les affinités
électives entre Paris et Prague
La simple lecture du titre "L'attraction et la
nécessité"
ne peut expliquer la présence de ce livre ici. Mais il
suffit de
regarder le sous-titre pour que l'éclaircississement
survienne :
"Musique tchèque et culture française au
XXè
siècle". Dix-sept études très pointues
examinent
chacune un point précis de
cette attraction mutuelle entre musiciens tchèques et
français et plus
largement entre artistes de ces deux parties de l'Europe et envisagent
en
quoi pour les Tchèques, Paris et l'art français
s'affirmèrent comme une
nécessité pour eux. Pour nous en tenir au domaine
de la
musique,
retenons les regards pénétrants balayant le
rôle de
la culture musicale
française dans le développement de la musique
tchèque dans les
contributions éclairées de Jiri Fukac, Sandra
Bergmannova, Jarmila
Gabrielova, entre autres, qui sous le bandeau "polarités et
inspirations" examinent les influences diverses auxquelles
cédèrent des
musiciens comme Bohuslav Martinů, Otakar
Jeremiáš,
Jaroslav Křička, Pavel Bořkovec et Alois Hába. Mais ce qui
nous
intéresse plus particulièrement, c'est l'article
intitulé "Leoš Janáček et la
France -
relations croisées" dans lequel la musicologue Marianne
Frippiat
pour la première fois interroge les archives pour dresser un
relevé des liens tentés par le compositeur avec
notre
pays et la plupart du temps
avortés pour des raisons qui nous semblent futiles. Elle
attire
l'attention sur l'attrait du compositeur morave pour la langue et la
culture françaises qui se manifesta de manière
aigüe
à plusieurs périodes de son existence, par son
étude de la langue, par son examen d'œuvres
littéraires et
musicales. Elle établit la liste des rendez-vous
manqués
avec des personnalités françaises et ceux qui
n'ont
finalement pas débouché sur quelque chose de
positif.
Enfin, elle examine les trois projets d'exécution en France
d'ouvrages de Janáček (Ballade de Blanik, Taras Bulba et Jenůfa) qui
n'aboutirent pas.
Décevantes pour le compositeur, ces relations avec la France
le
furent aussi pour les musiciens français et le public qui
dut se
contenter de quelques rares exécutions de sa musique (voir la
réception française de la musique de
Janáček par les concerts). A sa
mort, Janáček restait ignoré du plus
grand nombre de nos compatriotes…
Conclusion
Force est de constater la rareté des publications
réservées à la musique
tchèque et à
Janáček. Visiblement, la grande majorité des
musicologues français
délaisse la musique de ce pays et ses musiciens et ne lui
accorde pas l'importance qu'elle mérite.
Joseph Colomb - janvier 2006 (révision juin 2006)