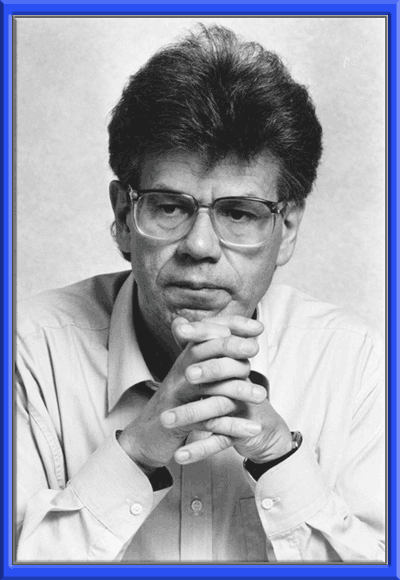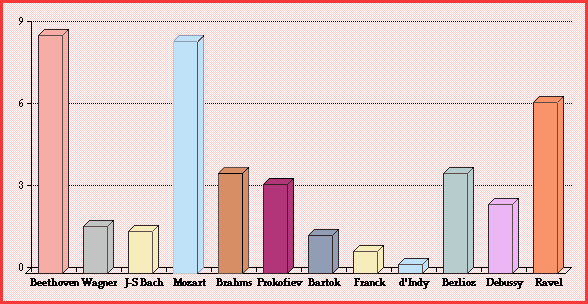
| La diffusion de la musique de Janáček en France | ||
| à travers les écrits | par les disques | par les concerts |
| du vivant de Janáček | avant 1939 | de 1939 à 1945 | de 1945 à 1969 | de 1969 à 1987 | de 1987 à 2000 | autres structures |
opéras |
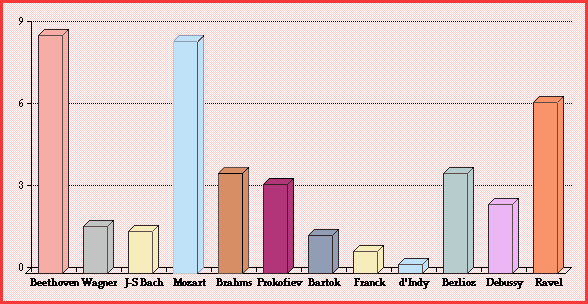
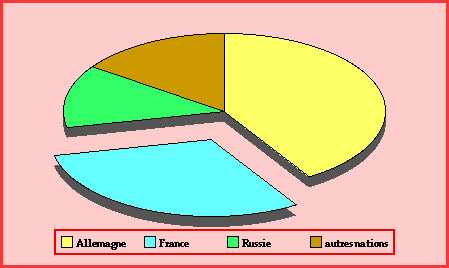
| compositeur | œuvre | date
de compo- sition |
opus | date d'exécution | chef | soliste |
| Bedrich Smetana | Fiancée vendue | 1866 | 4/11/71 | Louis Frémeaux |
||
| 12/5/77 | Zdeněk Mácal | |||||
| 11/4/85 | Gabriel Chmura | |||||
| la Vltava (Moldau) | 18/3/71 | Zdeněk Mácal | ||||
| Antonín Dvořák | Symphonie n° 4 | 1874 | B 41 | 25/11/71 | Jean-Pierre Jacquillat |
|
| Concerto pour piano | 1876 | B 63 | 12/5/77 | Zdeněk Mácal | Bruno Rigutto | |
| Sérénade pour vents | 1878 | B 77 | 26/2/77 | Cyril Diedrich | ||
| Danses slaves | 1878 | B 83 | 15/6/86 | Claude Bardon | ||
| 9/7/87 | Claude Bardon | |||||
| Suite tchèque | 1879 | B 93 | 20/9/86 | Claude Bardon | ||
| Concerto pour violon | 1879/80 | B 96/ B 108 |
27/2/75 | Serge Baudo | Milan Bauer | |
| Symphonie n° 6 | 1880 | B 112 | 7/2/85 | Ralf Weikert | ||
| Symphonie n° 7 | 29/3/73 | Zdeněk Mácal | ||||
| 3/12/81 | Gabriel Chmura | |||||
| 17/4/85 | Stéphane Cardon | |||||
| Symphonie n° 8 | 1889 | B 163 | 13/12/79 | Serge Baudo | ||
| Symphonie n° 9 du Nouveau Monde | 1893 | B 178 | 21/11/74 | Antonio Janigro | ||
| 17/5/79 | Witold Rowicki | |||||
| 30/9/81 | Pierre Stoll | |||||
| 6/11/85 | Serge Baudo | |||||
| Concerto pour violoncelle | 1895 | B 191 | 24/10/74 | Serge Baudo | Mstislav Rostropovitch | |
| 29/6/76 | Serge Baudo | Maurice Gendron | ||||
| 8/7/76 | Serge Baudo | Maurice Gendron | ||||
| Leoš Janáček | Taras Bulba | 1918 | VI/15 | 9/3/72 | Theodor Gushlbauer | |
| Josef Suk | Sérénade | 6 | 31/1/74 | Serge Baudo | ||
| Bohuslav Martinů | Symphonie n° 1 | 1942 | H 289 | 18/12/69 | Zdeněk Mácal | |
| Lidice | 1943 | H 296 | 13/12/79 | Serge Baudo | ||
| Concerto pour piano n° 3 | 1948 | H 237 | 13/12/79 | Serge Baudo | Josef Palenicek |